août062015
La « propriété intellectuelle » c'est le viol ! deuxième partie
dans la catégorie Informatologie
 Dans le précédent billet, nous sommes partis du titre d'un article de Richard Stallman – ''Vous avez dit « propriété intellectuelle » ? Un séduisant mirage. – pour analyser ce qui sous-tend et ce qu'implique ce terme de « propriété intellectuelle ». Cette analyse textuelle a permis de discerner l'absence de substance sur laquelle repose cette notion, qui se présente comme un mirage, agglomérant divers concepts dans une totalité floue dont l'on ne distingue plus les parties. Mais il est également apparu qu'il s'agissait d'une image bien réelle, forgée par les mots qui la définissent et cela depuis qu'ils ont été prononcés, et qui s'imposait, empreinte d'une séduction trompeuse.
Dans le précédent billet, nous sommes partis du titre d'un article de Richard Stallman – ''Vous avez dit « propriété intellectuelle » ? Un séduisant mirage. – pour analyser ce qui sous-tend et ce qu'implique ce terme de « propriété intellectuelle ». Cette analyse textuelle a permis de discerner l'absence de substance sur laquelle repose cette notion, qui se présente comme un mirage, agglomérant divers concepts dans une totalité floue dont l'on ne distingue plus les parties. Mais il est également apparu qu'il s'agissait d'une image bien réelle, forgée par les mots qui la définissent et cela depuis qu'ils ont été prononcés, et qui s'imposait, empreinte d'une séduction trompeuse.
Il convient à présent d'examiner les questions qu'ont soulevées cette première analyse et, en premier lieu, de s'interroger sur les origines de ce mirage de la « propriété intellectuelle ». Comment ce mirage a-t-il été construit – c'est-à-dire quel a été le processus historique ayant conduit à parler de « propriété intellectuelle » ? Par qui – c'est-à-dire quels ont été les sujets de ce processus historique ? Dans quel but – c'est-à-dire quel a été l'objectif présidant à forger le concept englobant de « propriété intellectuelle » pour désigner les différents droits qu'il rassemble artificiellement ? Avec quels matériaux – c'est-à-dire qu'est-ce qui caractérise ces droits qu'englobe la « propriété intellectuelle » par rapport à ce qui n'en fait pas partie ? Pourquoi lui avoir donné cette forme – c'est-à-dire pourquoi avoir choisi les termes de propriété et intellectuelle pour nommer ce concept ?
C'est un euphémisme que de qualifier d'abondante la littérature académique sur la « propriété intellectuelle ». Cela fait maintenant plus de dix ans que j'y puise au gré des luttes auxquelles j'ai activement participé, que ce soit sur les brevets logiciels, le droit d'auteur sur Internet, ou les divers droits – brevet et droit d'auteur spécifique, mais aussi droit des marques, sur les bases de données, etc. – portant sur les logiciels. Mais depuis cinq mois, je me suis plongé dans les profondeurs de cette littérature foisonnante, afin d'y dénicher ce qui a spécifiquement trait à l'expression « propriété intellectuelle » elle-même : sa genèse, son existence et sa forme – soit, l'origine et la raison d'être de ce concept englobant divers droits et la forme qu'il prend de « propriété » réduite au qualificatif « intellectuelle ». C'est cette exploration bibliographique que relate ce second billet.
1re partie : Stupeur et dévoilement
3e partie : Le capital imaginaire
Théorie du droit des auteurs, Auguste-Charles Renouard
Théorie des droits sur les inventions et sur leurs produits, Auguste-Charles Renouard
Embryologie juridique, Edmond Picard
Archéologie du savoir approprié

En première instance, c'est bien entendu dans le domaine du droit que la notion de « propriété intellectuelle » puise naturellement son existence. C'est au sein de l'ordre juridique qu'elle produit ses effets, sans qu'il soit besoin pour cela qu'une entité « propriété intellectuelle » ait une quelconque réalité matérielle. En écho au mirage décrit par Stallman[1], certains juristes[2] définissent ainsi la « propriété intellectuelle » comme une fiction juridique. C'est donc dans le champ du droit que l'on s'attend à en trouver la définition.
Or, si certains concepts juridiques a priori voisins – tels que la notion de propriété – sont parfaitement définis dans le droit interne français[3], la « propriété intellectuelle » n'y est jamais mentionnée, si ce n'est pour nommer le code[4] régissant chacun des droits qui en font partie. Et encore, le code de la « propriété intellectuelle » n'a-t-il vu le jour qu'à la faveur de l'entreprise générale de recodification à droit constant, initiée par le gouvernement Rocard à la fin des années 80[5] et jamais on ne trouve, dans les rapports et les débats sur cette loi de codification[6], de tentative de définir le terme, qui se trouve ainsi posé comme allant naturellement de soi, comme déjà connu et assimilé tant par la langue courante que par celle du droit[7]. Mais les mots ont un sens, et si le droit positif français est impuissant pour apporter une définition précise de la « propriété intellectuelle »[8], la jurisprudence constitutionnelle[9] ne laisse aucun doute sur le fait que le choix de cette terminologie exige qu'elle porte sur un sous ensemble de la propriété classique.
Quittons le droit purement français pour nous élever à l'ordre supranational de l'Union européenne, qui a acquis une compétence en matière de « propriété intellectuelle » s'étant principalement exercée par le biais de la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle[10]. Mais cette directive – nommée communément IPRED, de par son acronyme en anglais – ne définit pas davantage le concept de « propriété intellectuelle ». Tout au mieux, peut-on trouver dans une déclaration de la Commission européenne du 13 avril 2005, un inventaire des divers droits entrant dans le champ d'IPRED, sans toutefois que cette liste soit exhaustive[11]. Sur le plan communautaire européen également, ce manque de définition rigoureuse n'a pas empêché qu'au niveau juridique suprême[12] la « propriété intellectuelle » soit sans conteste possible incluse comme un aspect particulier du droit de propriété matérielle[13].
Mais, c'est à l'échelon supérieur du droit international public que les questions liées à la « propriété intellectuelle » ont récemment suscité le plus de débats. Depuis une vingtaine d'années, il n'est plus un accord commercial bi ou multilatéral qui n'inclut un chapitre, âprement contesté, sur la « propriété intellectuelle ». Tous s'appuient sur cette dernière comme étant constitutivement facteur de croissance économique, de développement social, de dissémination de la technologie et des échanges commerciaux, réduisant les entraves aux investissements et au commerce, etc.[14] Mais aucun n'en questionne l'existence, ne la justifie, ni même ne tente de la définir. Aux mieux, ces traités renvoient aux sections d'une autre convention internationale : l'Accord sur le respect des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ou Accord sur les ADPIC (TRIPS en anglais), signé en 1994 à Marrakech lors de la création de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)[15].
On n'apprendra rien d'autre quant à la nature et la justification de la « propriété intellectuelle » dans le texte de cet accord sur les ADPIC – qui constitue donc néanmoins la référence juridique actuelle à vocation universelle en la matière – que la liste des droits qu'elle recouvre[16] et les sempiternels bienfaits économiques et sociaux qu'elle emporte prétendument[17]. La « propriété intellectuelle »[18] se trouve ici consacrée en tant qu'agrégat fantasmagorique marqué du sceau de la propriété – ce qui est certes en tout point conforme au mirage dépeint par Richard Stallman. Mais le cadre dans lequel se situe les ADPIC – accord commercial sous l'égide de l'OMC – ne laisse pas le moindre doute quant à son exigence de marchandisation du savoir et de l'information
[19]. Car les ADPIC marquent une spécialisation économique dans la compétence des organisations internationales à régir la « propriété intellectuelle »[20]. En effet, avant les ADPIC, l'ONU était le forum législatif international dédié à la question. Les théories portant sur la « propriété intellectuelle » y étaient ainsi ouvertes à toute la panoplie des sciences sociales. Avec les ADPIC, se dévoile ainsi le champ prépondérant dans lequel elle doit être discutée : il s'agirait d'un concept avant tout économique. Par ce changement d'un contexte générique à un cadre réservé aux aspects commerciaux, le mirage de la « propriété intellectuelle » commence à s'expliquer par un besoin de marchandisation – nous ne manquerons pas de revenir sur ce point primordial.
Mais pour terminer de dresser le tableau juridique dans lequel se définit la « propriété intellectuelle », il faut encore s'arrêter sur la création en 1967 d'une agence de l'ONU spécifiquement destinée à traiter les questions à ce sujet : l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ou OMPI. Ici encore, l'essentiel ne se trouve pas dans le texte de la Convention instituant l'OMPI, qui se contente à nouveau de définir la « propriété intellectuelle » en énumérant – de manière non exhaustive et particulièrement large – les droits relatifs à celle-ci, évoquant simplement – outre l'inévitable auto-promotion circulaire de la « propriété intellectuelle » – l'objectif vague d'encourager l'activité créatrice
[21]. La création de l'OMPI n'en constitue pas moins un tournant historique majeur, en ce qu'elle vient clore toute discussion critique sur l'existence même du concept de « propriété intellectuelle ». En effet, puisqu'il existe désormais une institution exclusivement dédiée à l'administration, l'harmonisation et la promotion de diverses législations et ayant vocation à s'appliquer au monde entier[22], il ne peut plus être question d'interroger ni le rassemblement de ces dernières sous une entité générique, ni la désignation de celle-ci sous le vocable de « propriété intellectuelle ». Pour le dire autrement, avec l'OMPI, le mirage dénoncé par Richard Stallman prend forme et s'impose dorénavant à tous.
 Il y a dans la théorie de la « propriété intellectuelle » un avant et un après l'OMPI. D'ailleurs, Stallman ne s'y trompe pas en soulignant que
Il y a dans la théorie de la « propriété intellectuelle » un avant et un après l'OMPI. D'ailleurs, Stallman ne s'y trompe pas en soulignant que l'utilisation généralisée de l'expression « propriété intellectuelle » est une mode qui a suivi la création en 1967 de l'Organisation mondiale de la “propriété intellectuelle”
[23] Cette mode s'est propagée dans la littérature académique où la grande majorité des recherches publiées après l'avènement de l'OMPI souffrent d'un aveuglement prenant le mirage de la « propriété intellectuelle » pour une réalité établie. On y trouve ainsi d'innombrables articles[24] croyant apporter une réflexion pertinente sur le droit d'auteur, les brevets, les marques, etc. Mais alors qu'ils ne portent que sur un seul des instruments juridiques disparates que l'on a regroupés sous le terme de « propriété intellectuelle » ou sur un sous-ensemble de ceux-ci, en nommant « propriété intellectuelle » l'objet de leur étude, ils en viennent à totalement se discréditer en avançant des thèses qui ne peuvent aucunement s'appliquer aux autres droits inclus qu'emporte avec lui ce même vocable. Ainsi, depuis que l'OMPI a offert un visage institutionnalisé à la « propriété intellectuelle », les études théoriques partent de la réalité de cette figure et passent complètement à côté du corps chimérique sur les épaules duquel elle repose.
C'est donc plutôt dans la bibliographie datant d'avant l'OMPI qu'il faut se plonger afin de comprendre comment celle-ci raconte justement l'histoire de la création de cette chimère. Or, si l'on en croit son autobiographie officielle[25], cette morphogenèse ayant abouti à la formation de l'OMPI aurait suivi un développement parfaitement logique, quasi naturel. Le désir d'une protection internationale de la “propriété intellectuelle”
se serait manifesté comme une nécessité […] lorsqu'en 1873, à Vienne, des exposants étrangers ont refusé de participer au Salon international des inventions par crainte que leurs idées soient dérobées et exploitées sur le plan commercial dans d'autres pays
. De là, aurait été conclue en 1883 la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, premier instrument international majeur conçu pour aider les habitants d'un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d'autres pays par des titres de propriété industrielle tels que les brevets d'invention, les marques, les dessins ou modèles industriels
. Celle-ci fut bientôt suivie en 1886 par la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Chacune de ces conventions ayant créé un Bureau international chargé d'assurer les tâches administratives
, c'est tout naturellement qu'en 1893, ces deux petits bureaux ont été réunis pour former une organisation internationale appelée Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (plus connue sous le sigle BIRPI)
[26]. Enfin, suite à l'entrée en vigueur de la Convention de Stokholm de 1967, les BIRPI devenaient l'OMPI
. La nature aurait ainsi produit inéluctablement son ouvrage : désir d'enfant – exposition de Vienne —, formation des gamètes complémentaires – Convention de Paris sur la propriété industrielle et Convention de Berne sur la propriété littéraire et artistique –, fécondation – formation des BIRPI – et éclosion de l'œuf – naissance de l'OMPI.
Cependant – si on l'examine plus minutieusement au microscope – il est déjà possible de déceler dans cet enfantement de l'OMPI, qui nous est présenté comme étant parvenu à son terme sans incident, un certain nombre d'anomalies génétiques, révélant qu'il tient bien davantage de la procréation artificielle que de l'accouchement naturel. Tout d'abord, il est quelque peu hâtif de voir dès l'exposition universelle de Vienne de 1873 un désir d'engendrer un être aussi complexe que la « propriété intellectuelle ». Les rapports sur cette exposition confirment que la principale préoccupation des participants au Salon international des inventions se limitait à des considérations industrielles sur les brevets[27]. Il s'en suit que l'embryon qui s'est développé à la suite de l'exposition universelle de Vienne aurait tout aussi bien pu arrêter sa croissance à l'unification internationale du droit des brevets, sans même atteindre le stade de la Convention de Paris[28], qui a d'ores et déjà consacré sans ambages[29] un être composite, formellement identifié à une sorte de propriété : la « propriété industrielle ». Rien n'obligeait ensuite d'y agréger le champ couvert par la Convention de Berne, dans laquelle, par contraste, le terme de « propriété » avait soigneusement été évité[30].
Ces premières difficultés surmontées, la phase de création des BIRPI semble être le dernier point crucial à partir duquel rien n'aurait su empêcher l'avènement de l'OMPI – et avec, celui du mirage de la « propriété intellectuelle ». En effet, cette jonction des bureaux institués respectivement par les Conventions de Paris et de Berne, marque l'unification au sein de la même entité de ce qui était rassemblé d'une part sous la « propriété industrielle » et d'autre part sous la « propriété littéraire et artistique » – la réunion de ces deux branches constituant encore aujourd'hui la définition canonique de la « propriété intellectuelle »[31]. Or les raisons de ce rapprochement restent pour le moins obscures. Il n'a fait l'objet d'aucune décision de la part d'un quelconque accord international entre les États membres de l'Union de Paris et ceux de l'Union de Berne et la documentation de cet événement pourtant décisif reste extrêmement pauvre[32], voire quasiment inexistante. Ce n'est qu'en fouillant dans les Actes de la Conférence de Stokholm de 1967, que j'ai pu en trouvé la motivation, qui s'avère en fin de compte se limiter à une simple question de logistique et de rationalisation économique[33].
On ne peut évidemment s'arrêter à cette seule explication pratique pour justifier le tournant historique que fut l'institutionnalisation du mirage de la « propriété intellectuelle » avec la création des BIRPI préfigurant celle de l'OMPI. Il nous faut donc poursuivre notre recherche plus en avant, en remontant toujours plus loin dans l'histoire, avant la mise en place d'une législation internationale rassemblant divers droits sous la dénomination de « propriété intellectuelle »[34]. C'est-à-dire qu'il nous faut opérer un renversement dans notre analyse et revenir au niveau national dans lequel droits d'auteur, brevet, marques, dessins et modèles, etc. se sont séparément développés et tenter de découvrir dans ces développements disjoints s'il existe des motifs communs expliquant qu'ils aient tous fini sous la houlette de la « propriété intellectuelle ».
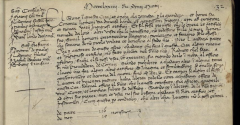 La littérature sur la préhistoire de la « propriété intellectuelle » s'accorde à faire remonter la première manifestation d'un des droits qu'elle englobe aujourd'hui au VIe siècle av. J.-C. avec la loi de Sybaris. Cette dernière offrait un monopole d'un an à tout cuisinier inventant
La littérature sur la préhistoire de la « propriété intellectuelle » s'accorde à faire remonter la première manifestation d'un des droits qu'elle englobe aujourd'hui au VIe siècle av. J.-C. avec la loi de Sybaris. Cette dernière offrait un monopole d'un an à tout cuisinier inventant de nouvelles et succulentes recettes
[35]. On est bel et bien en présence d'un droit en tout point comparable aux brevets actuels. Cependant, nulle référence n'est faite à la notion de propriété et l'on ne songe nullement à rapprocher ce monopole d'un quelconque droit d'auteur sur l'expression du texte de la recette, ni d'une marque de fabrique pour le cuisinier privilégié, ni d'aucun des autres droits sous-entendus par le mirage de la « propriété intellectuelle ». Il faut toutefois remarquer qu'il n'est pas innocent que cette loi soit née dans une des citées les plus prospères de la Grande-Grèce, au luxe proverbial et au commerce dynamique, son but explicite étant d'ailleurs de favoriser la concurrence.
De même, c'est dans le berceau proto-capitaliste de la Venise de la Renaissance que s'éveillèrent nombre d'aspects qui s'agglutinent aujourd'hui dans l'être chimérique de la « propriété intellectuelle »[36]. Si les octrois de privilèges concédant un monopole commercial, à l'instar des brevets de nos jours, étaient déjà connus aux XIVe et XVe siècles dans toute l'Europe continentale, aussi bien qu'en Grande-Bretagne, ceux-ci étaient encore soumis à un système de demande et d'accord individuels. Le décret vénitien du 19 mars 1474 instaura pour la première fois une loi générale – dite Parte Veneziana — pour fixer des critères déterminés permettant la délivrance de monopoles d'exploitation de dix ans en échange de la divulgation des inventions[37]. C'est précisément ce compromis économique et social qui fondera tout système de brevets jusqu'à nos jours. Mieux, le préambule de cette Parte Veneziana – ici encore sans aucun recours au lexique de la propriété – pose déjà les germes du socle théorique sur lequel s'appuieront les principales justifications, non seulement des brevets, mais également des droits d'auteurs, et finalement du mirage entier de la « propriété intellectuelle » : incitation à l'innovation et la création qui ne seraient prétendument pas entreprises sans une telle protection ; récompense du travail fourni et autorisation d'en tirer profit ; défense de l'honneur et de la personnalité des auteurs et inventeurs qui s'exprimeraient dans leurs créations ; et accroissement de la prospérité économique et sociale qu'entrainerait quasi mécaniquement la simple existence de ces constructions juridiques.
Sous l'impulsion des commerçants étrangers, cette première loi vénitienne sur les brevets se répandra très vite dans le monde occidental. Mais avant d'y revenir, restons encore un peu dans cette Venise des XVe et XVIe siècles. Car si la Parte Veneziana est née avec l'expansion de l'industrie textile, un bouleversement technologique concomitant va avoir une incidence majeure dans l'entremêlement des divers droits de la « propriété intellectuelle » : l'invention de l'imprimerie moderne, apparue à Venise aux alentours de 1470. En effet, en tant que moyen technique de production, celle-ci donna lieu à de nombreuses prises de brevets, par exemple sur l'impression en caractères italiques. Ensuite, en tant que produisant des supports permettant l'expression à grande échelle, l'imprimerie est directement liée à la notion de droits d'auteur. L'exclusivité pour l'impression d'un ouvrage était accordée aux imprimeurs et libraires par le biais de privilèges, mais c'est également à Venise qu'une législation formelle[38] apparut en ce domaine entre 1544 et 1545, interdisant l'impression de tout ouvrage sans l'autorisation de l'auteur ou de ses héritiers[39]. Troisièmement, en tant que vecteur de diffusion de masse des connaissances, l'imprimerie – avec, notamment, les nombreux manuels scientifiques et techniques qu'elle a permis de produire – remet en cause les secrets de fabrication, largement utilisés à l'époque au sein des corporations et guildes. Enfin, en tant qu'industrie structurée par les entreprises que sont imprimeurs et libraires, les produits de l'imprimerie sont identifiés par des sceaux de corporation – ancêtres de nos marques commerciales en vigueur depuis le Moyen-Âge – afin de garantir la qualité des ouvrages.
Ce que l'épisode fondateur vénitien – et dans une moindre mesure celui de Sybaris avant lui – révèle en premier lieu, c'est l'extraordinaire contingence de l'être fantasmagorique et composite de la « propriété intellectuelle ». Il aura en effet fallu un terreau très particulier, tant sur les plans historique et géographique que social ou technique, pour que non seulement chacun des droits qui le composent puisse germer, mais également pour qu'il se produise entre eux tous une hybridation. Et ce contexte spécifique, sans lequel la « propriété intellectuelle » aurait très bien pu ne jamais voir le jour, n'est autre que le développement de la modernité capitaliste. La proximité entre les différentes branches de la « propriété intellectuelle » – brevets, droits d'auteur, marques, etc. – apparaît ainsi due au fait qu'elles aient successivement poussé durant le même moment historique déterminant dans l'émergence du capitalisme. Chacune a été semée dans le champ fertile d'un haut lieu de commerce. Chacune a été cultivée sous l'impulsion d'entrepreneurs, commerçants et marchands. Chacune a pu croître et se mêler aux autres en s'appuyant sur le même tuteur de la rupture technologique fondamentale que constitue l'imprimerie pour l'apparition du capitalisme[40]. Chacune, enfin, a donné des fruits destinés à offrir un avantage concurrentiel à ceux qui les récoltent. Il faut cependant noter qu'à ce stade précoce, aucune n'était revêtue d'un feuillage prenant la forme d'une sorte de propriété.
Ce même schéma de concomitance avec le développement du capitalisme va se retrouver tout au long des évolutions majeures subséquentes des divers droits de « propriété intellectuelle ». Ainsi, c'est dans l'Angleterre pionnière de l'industrialisation[41], qu'est établi en 1623 le Statute of Monopolies[42], loi sur les brevets, suivi en 1710 par le Statute of Anne[43], loi sur le droit d'auteur. Si la propriété est totalement absente de la loi sur les brevets, elle est évoquée dans la loi d'Anne, mais sans pour autant être explicitée ni fondée, la confinant à un rôle négligeable[44] – semblant limité à la propriété des supports matériels –, jusqu'à en supprimer toute mention dans le titre officiel de la loi[45].
Et ce n'est qu'à la faveur de la révolution française[46], dans un contexte d'abandon général des privilèges, que le paradigme de la propriété[47] est explicitement pris pour justifier tant le droit des brevets, avec la loi du 7 janvier 1791[48], que le droit de représentation, avec la loi des 13 et 19 janvier 1791[49], et le droit d'auteur, avec la loi du 19 et 24 juillet 1793[50] – ces différents droits étant jusqu'alors accordés à la discrétion du roi[51]. Disposant avec le rattachement à la propriété d'une base commune, droit d'auteur et brevet, malgré les divergences entre les objets qu'ils régulent[52], vont pouvoir être défendus avec les mêmes arguments. Il est ainsi frappant de constater la similitude des discours du chevalier de Boufflers, de Le Chapelier ou de Lakanal – rapporteurs respectifs des lois susmentionnées –, l'un empruntant et s'appuyant sur l'autre[53] et trouvant leur inspiration commune dans les mémoires de Louis de Héricourt[54], publiées en 1725, en défense des libraires parisiens. Tous partent d'une analogie avec la propriété matérielle pour en décréter la naturalité d'une propriété sur les fruits du travail intellectuel, que ce soit celui de l'inventeur, de l'auteur ou de l'artiste.
Il faut toutefois noter que ce vent révolutionnaire, balayant les privilèges et déposant en lieu et place un voile de propriété, n'a pas soufflé sur le droit des marques[55], buttant sur le fait que ce dernier se matérialisait à l'époque dans les sceaux de corporation[56]. Le libéralisme révolutionnaire exigeant le démantèlement des corporations, les marques de fabrique devront attendre encore[57] avant de rejoindre l'agrégat prenant forme en affublant d'un caractère de propriété brevets et droits d'auteurs. Nous ne manquerons pas d'y voir un renforcement[58] du caractère contingent[59] de ce rattachement à la propriété.
 Arrivés à ce point de notre analyse historique, nous pouvons l'arrêter là afin d'aborder l'aspect purement théorique de la « propriété intellectuelle ». Jamais en effet, les débats n'ont été aussi virulents, mais surtout jamais ils n'ont touché autant à ses principes fondamentaux qu'au XIXe siècle. Entre la révolution française et la conclusion des Conventions internationales qui aboutiront in fine à la création de l'OMPI, les lois sur les brevets, les droits d'auteur, les marques, les dessins et modèles[60], etc. se sont succédées en France et dans le monde entier, au gré des fluctuations théoriques dans chacun de ces domaines.
Arrivés à ce point de notre analyse historique, nous pouvons l'arrêter là afin d'aborder l'aspect purement théorique de la « propriété intellectuelle ». Jamais en effet, les débats n'ont été aussi virulents, mais surtout jamais ils n'ont touché autant à ses principes fondamentaux qu'au XIXe siècle. Entre la révolution française et la conclusion des Conventions internationales qui aboutiront in fine à la création de l'OMPI, les lois sur les brevets, les droits d'auteur, les marques, les dessins et modèles[60], etc. se sont succédées en France et dans le monde entier, au gré des fluctuations théoriques dans chacun de ces domaines.
La première constatation que l'on peut tirer de ce foisonnement théorique est l'oscillation quasi permanente principalement des droits d'auteur, mais également des brevets, entre, d'un côté, un attrait absolu, tendant à l'identification parfaite[61], et de l'autre côté, une répulsion tout aussi intense de la catégorisation de ces droits dans le domaine de la propriété.
Du point de vue de l'assimilation à la propriété, on trouve ses principales racines philosophiques[62] – comme le montraient déjà les justifications des lois révolutionnaires que nous venons de voir – chez Locke[63] – bien qu'à ma connaissance ce dernier ne se soit pas directement exprimé à propos des différents droits de « propriété intellectuelle ». Mais la théorie lockienne de la propriété matérielle résidant – pour la résumer grossièrement – en un droit naturel à s'approprier les fruits de son travail, elle pouvait, sans difficulté apparente, être reprise pour revendiquer la propriété de l'auteur, de l'artiste ou de l'inventeur sur les produits de leurs travaux respectifs, qualifiés d'« intellectuels ». Le second pilier philosophique supportant une voûte au fronton de laquelle s'inscrit la marque de la propriété repose sur les briques de la théorie personnaliste façonnée par Kant, les Lumières[64] ou encore Hegel[65]. Selon cette approche, la production d'idées, le travail intellectuel, la pensée, etc., bref tout ce que l'on considère – abusivement, nous y reviendrons… – comme objet des actuels droits de « propriété intellectuelle », représente une expression de la personnalité de celui qui en est l'auteur et constitue en cela le plus haut degré de propriété – argument qui, ici encore, fut utilisé dans les lois révolutionnaires.
Notons d'emblée la parenté entre ces fondations philosophiques et celles qui ont forgé l'idéologie capitaliste. Il n'est en effet pas innocent que la « propriété intellectuelle » et le mode de société basé sur le fétichisme de la marchandise se basent au niveau théorique le plus profond sur les travaux philosophiques de Locke ou Kant[66]. Cela suggère une fois de plus que l'être fantasmagorique de la « propriété intellectuelle » est tout entier déterminé par des impératifs de marchandisation.
Mais revenons tout d'abord sur la fragilité de ces piliers philosophiques, que n'ont pas manqué d'ébranler les études théoriques du XIXe siècle critiquant la catégorisation en tant que propriété. Celles-ci sont pléthore et plutôt que de tenter vainement de dresser ici l'inventaire linéaire, forcément imparfait, de leurs arguments[67], nous pouvons en extraire les points les plus intéressants pour notre propre étude en partant de trois textes emblématiques, publiés à cette époque et que j'ai retranscrits en intégralité sur ce blog. Les deux premiers exposent les théories sur, respectivement, les droits d'auteur et les brevets, d'Augustin-Charles Renouard, personnage non moins emblématique du développement de la « propriété intellectuelle » au XIXe siècle.
Car si les débats furent à cette époque extrêmement nourris quant à la question de reconnaître ou au contraire de nier le caractère de propriété aux droits d'auteur, aux brevets, aux marques, etc., le regroupement de ces différents droits sous la même enseigne n'a jamais été explicitement discuté. Pour autant, cette union est implicitement posée par la médiation d'acteurs qui ont théorisé chacune de ces matières, impliquant ainsi qu'elles pouvaient être embrassées depuis un même point de vue[68]. Charles Renouard est l'un de ces acteurs et, semble-t-il, l'un des plus influents. Petit-fils de marquis, fils d'un grand libraire bourgeois, ce libéral convaincu, né en plein durant la réaction thermidorienne, a tout à tour été professeur de philosophie, avocat, conseiller d'État et secrétaire du ministère de la justice, puis député de la Somme dans la majorité conservatrice et pair de France sous la Monarchie de Juillet, dévoué personnellement aux princes de la famille d'Orléans, conseiller à la cour de cassation pendant le Second Empire, puis conseiller honoraire, procureur général près de la cour de cassation, pourfendeur de la Commune dans son discours inaugural, rallié au gouvernement d'Adolphe Thiers, sénateur inamovible, vice-président de la Société d'économie politique et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Mais ce jurisconsulte économiste[69] est surtout connu pour ses écrits et propos sur les faillites et banqueroutes, les lois de succession, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles de fabrique et, bien entendu, sur les inventions industrielles et les écrits et œuvres d'art.
 Plongeons donc dans ces écrits de Charles Renouard ! Ce qui frappe en premier lieu lorsque l'on remonte à la surface après la traversée de son Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux-arts et de son Traité des brevets d'invention, c'est le parallélisme avec lequel sont étudiées ces deux branches de la « propriété intellectuelle », confirmant une nouvelle fois implicitement leur rapprochement possible dans une analyse commune. Mais en lisant conjointement les chapitres tirés de ces traités où Renouard expose sa théorie – chapitres intégralement retranscrits ici et là –, il est beaucoup plus instructif de s'intéresser aux points où, défiant toute loi géométrique, ces lignes d'analyses parallèles se croisent, s'écartent ou se rapprochent, voire se confondent tout à fait.
Plongeons donc dans ces écrits de Charles Renouard ! Ce qui frappe en premier lieu lorsque l'on remonte à la surface après la traversée de son Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux-arts et de son Traité des brevets d'invention, c'est le parallélisme avec lequel sont étudiées ces deux branches de la « propriété intellectuelle », confirmant une nouvelle fois implicitement leur rapprochement possible dans une analyse commune. Mais en lisant conjointement les chapitres tirés de ces traités où Renouard expose sa théorie – chapitres intégralement retranscrits ici et là –, il est beaucoup plus instructif de s'intéresser aux points où, défiant toute loi géométrique, ces lignes d'analyses parallèles se croisent, s'écartent ou se rapprochent, voire se confondent tout à fait.
Ainsi tout un passage est repris mot pour mot dans les deux théories, afin de détailler la conception qu'a Renouard de la propriété matérielle classique, qu'en ardent partisan des thèses de Locke, Smith ou J.-B. Say, il relie à la catégorie de travail, épousant sans le dire pour la propriété matérielle, le premier pilier philosophique que nous avons vu soutenir la « propriété intellectuelle ». Mais cette défense acharnée de la propriété classique fera justement récuser à Renouard toute application dans le domaine intellectuel. Parler de propriété à propos des droits d'auteur, comme à propos des brevets, pervertirait le concept si fondamental à l'économie marchande de la société capitaliste.
Pourquoi ? L'un des principaux arguments consiste en ce que la propriété se caractérise par sa perpétuité, alors que dans les deux cas, brevets et droits d'auteur ne peuvent être que temporaires. L'argument fut l'un des plus débattus au XIXe siècle. Il est ainsi cocasse de voir dans un opuscule[70] publié par Proudhon en réaction à une loi sur la perpétuité du droit d'auteur, que le polémiste, célèbre pour sa critique de la propriété équivalant au vol, se fend d'un soutien à cette même propriété classique pour s'opposer à la perpétuité en matière de « propriété intellectuelle ». Au passage, la confusion de Proudhon est totale lorsqu'il soutient que les droits d'auteur ne sauraient être perpétuels puisque les brevets ne le sont indiscutablement pas. Renouard note d'ailleurs que sur ce refus d'un caractère perpétuel, il y a unanimité complète
en ce qui concerne les brevets, alors que seule une presque unanimité
se dégage sur les droits d'auteur.
Ici, alors qu'ils soutiennent la même conclusion de temporarité des droits, les arguments divergent entre les deux branches, car si elles sont confusément réunies par la notion de production de l'intelligence
, la nature de l'une et l'autre de ces nouveautés de combinaison dans les résultats de la pensée
divergent. Le caractère utilitaire des inventions monopolisées par des brevets, leur application directe dans l'industrie productive, qui plus est dans un but d'accroissement de la compétitivité, viennent se heurter aux restrictions à la liberté d'entreprise et de commerce qu'impliquerait une perpétuité des brevets[71]. C'est certainement pourquoi la durée maximale des brevets resta limitée à quinze ans tout au long du XIXe siècle[72].
Alors que le droit d'auteur n'a cessé d'être renforcé dans chaque loi étendant toujours plus la durée de la protection échouant aux ayants droits après la mort de l'auteur. Sans utilité directe apparente dans la production capitaliste, les œuvres littéraires ou artistiques étaient libérées des réticences à la monopolisation des inventions industrielles. Par contre, leur nature on ne peut plus personnelle[73] nous amène à considérer le second pilier philosophique que nous avons identifié supra. Il faut d'ailleurs bien admettre qu'il ne pouvait soutenir grand chose d'autre que la « propriété littéraire et artistique » et n'a que peu à voir avec les inventions industrielles[74]. Significativement, Renouard militant du reste énergiquement pour la suppression de ce terme de « propriété littéraire », alors qu'il aurait presque été prêt à une concession de langage pour qualifier les brevets d'un type de propriété distinct de la propriété traditionnelle. Il jouera de la fragilité de ce deuxième pilier pour le déconstruire et le reconstruire dans un sens inverse, déniant toute possibilité d'appropriation des productions de l'esprit, puisque ces dernières sont indissociablement attachées à la personnalité de leur auteur, or l'homme ne peut s'approprier que ce qui est extérieur à l'homme.
S'il confond encore ici inventions industrielles et œuvres littéraires et artistiques dans le terme générique d'ouvrages de l'esprit
, sa démonstration, basée sur la théorie de Kant sur les droits respectifs des auteurs et des éditeurs[75], ne laisse aucun doute sur le fait que seul le droit d'auteur y est traité. Voyons plus précisément le raisonnement de Kant, adopté par Renouard. Au niveau le plus élémentaire, Kant distingue, dans le livre, ses exemplaires matériels des propos qui y sont imprimés. Remarquons au passage que cette distinction l'amène à en faire une autre excluant de sa théorie, en tant qu'ouvrages et non discours, les œuvres des arts plastiques[76], faisant écho aux rares écrits romains qui nous sont parvenus touchant aux matières considérées par la « propriété intellectuelle »[77]. Notons également que cette distinction entre le support et l'œuvre intellectuelle[78] sera au cœur des débats de la fin du XXe siècle sur le droit d'auteur, lorsque l'informatisation a rendu quasi obsolète tout support physique[79]. Mais revenons à Kant et Renouard, pour qui la propriété des exemplaires ne pose aucun problème, s'agissant d'objets matériels, alors que le contenu d'un livre doit être envisagé comme discours.
Dès lors, l'édition et la copie ne sont rien d'autre qu'un service que l'éditeur rend à la société au nom de l'auteur. Il ne saurait y avoir de propriété ni de monopole perpétuel sur ce service. Le droit qui s'y réfère doit plutôt être vu comme une sorte de contrat social[80] entre l'auteur et la société : pour que le premier enrichisse la seconde en lui livrant sa pensée, ce qui libère celle-ci de toute appropriation possible, la seconde est prête à accorder au premier une exclusivité temporaire.
On touche ici aux limites de la critique de Renouard. Car si celui-ci écarte clairement tout rattachement à la propriété des droits qu'on appelle, erronément selon lui, de « propriété intellectuelle », il n'en reste pas moins qu'il défend exactement les mêmes droits, pour peu qu'ils portent une autre étiquette. Le même constat[81] peut être fait à propos du troisième et dernier texte qu'il est maintenant temps d'introduire, Renouard faisant d'ailleurs tout à fait sienne la thèse qui y est développée.
 Il s'agit d'un article publié par le jurisconsulte belge Edmond Picard. J'ai choisi de le retranscrire dans son intégralité car, au-delà de l'élégance du style inimitable de la bourgeoisie du XIXe siècle, que Picard manie avec encore davantage de dextérité que Renouard et qui confère une telle limpidité à sa démonstration qu'on la suit avec délice, au-delà donc de la forme, la puissance argumentative au fond de cette démonstration me paraît inégalée. Dans tout le corpus théorique maturé au XIXe siècle, ni dans les analyses contemporaines dans les siècles suivants, jamais critique de la notion de propriété appliquée à ce qu'on range sous le vocable de « propriété intellectuelle » , n'a été aussi radicale, au sens étymologique où elle problématise les racines de la question.
Il s'agit d'un article publié par le jurisconsulte belge Edmond Picard. J'ai choisi de le retranscrire dans son intégralité car, au-delà de l'élégance du style inimitable de la bourgeoisie du XIXe siècle, que Picard manie avec encore davantage de dextérité que Renouard et qui confère une telle limpidité à sa démonstration qu'on la suit avec délice, au-delà donc de la forme, la puissance argumentative au fond de cette démonstration me paraît inégalée. Dans tout le corpus théorique maturé au XIXe siècle, ni dans les analyses contemporaines dans les siècles suivants, jamais critique de la notion de propriété appliquée à ce qu'on range sous le vocable de « propriété intellectuelle » , n'a été aussi radicale, au sens étymologique où elle problématise les racines de la question.
L'Embryologie juridique d'Edmond Picard est en effet une dissection des entrailles les plus profondes de la logique du droit. Y sont analysés ce qui au niveau le plus fondamental peut constituer le sujet et l'objet du droit ainsi que le rapport constitué par ce dernier entre son sujet et son objet. Picard dévoile ainsi le noyau de la répartition de tout droit isolé entre les trois catégories de droits réels, droits d'obligations et droits personnels. Cette mise à nue des mécanismes fondamentaux du droit conduit Picard à conclure que les soi-disant droits de « propriété intellectuelle » ne peuvent trouver leur place dans aucune catégorie de cette répartition tripartite. Ce pour quoi il propose de les ranger dans une nouvelle quatrième catégorie sui generis qu'il suggère d'appeler droits intellectuels
.
Nous tirerons deux enseignements principaux de l'article d'Edmond Picard. Le premier est que la rigueur de sa démonstration ne peut que convaincre de la contradiction essentielle que renferme le terme de « propriété intellectuelle », dont la nature intrinsèque est étrangère à la forme qu'on lui donne, c'est-à-dire à la propriété. La « propriété intellectuelle » n'est pas une propriété quand bien même on l'appellerait ainsi. Cette contradiction s'est ainsi insinuée jusque dans les lois[82] et les tribunaux[83] du XIXe, pour finir, comme nous l'avons vu, à cependant être assumée dans les institutions de la fin de ce siècle jusqu'à la création de l'OMPI.
Mais c'est là le second point à retenir du texte de Picard – et que nous avions déjà relevé chez Renouard – : quand bien même le caractère de propriété lui est indiscutablement dénié, le rapprochement entre les différents droits y est négativement légitimé. Qu'on les embrasse tous sous le terme de « droits intellectuels » ne change en rien le fait qu'on est invité à les considérer comme un tout homogène, que Picard justifie sans explication en considérant que leur objet unitaire se trouve dans les productions de l'esprit
. Par conséquent, les étiqueter en tant que « propriété intellectuelle » – ce qui donc finira par advenir – se révèle n'être qu'une pure question d'opportunité. Et distinguer cette forme de propriété par le qualificatif d'« intellectuelle » ne revient en fin de compte qu'à prendre acte de la contradiction en suggérant qu'il ne s'agit cependant pas de propriété au sens où on l'entend d'ordinaire.
 Il devrait maintenant être clair au terme de cette longue exploration juridique, législative, historique, philosophique et théorique, que les motivations, ayant conduit à ce que s'impose opportunément la désignation de cette propriété qui n'en est pas une, s'inscrivent sur le terrain économique[84]. Ce sont les acteurs économiques influents qui de tout temps ont poussé aux renforcements législatifs de la « propriété intellectuelle » et à son institutionnalisation juridique. Ce sont des contextes de politique économique bien spécifiques qui ont présidé à son évolution historique[85]. C'est aux sources philosophiques de l'économie politique qu'elle continue de s'abreuver en dépit des contradictions logiques que cela entraîne. C'est enfin – et peut-être surtout – en termes de « travail »[86], de « production », de « marchandise », de « valeur »[87], etc. que la théorie parvient à implicitement légitimer son unité artificielle.
Il devrait maintenant être clair au terme de cette longue exploration juridique, législative, historique, philosophique et théorique, que les motivations, ayant conduit à ce que s'impose opportunément la désignation de cette propriété qui n'en est pas une, s'inscrivent sur le terrain économique[84]. Ce sont les acteurs économiques influents qui de tout temps ont poussé aux renforcements législatifs de la « propriété intellectuelle » et à son institutionnalisation juridique. Ce sont des contextes de politique économique bien spécifiques qui ont présidé à son évolution historique[85]. C'est aux sources philosophiques de l'économie politique qu'elle continue de s'abreuver en dépit des contradictions logiques que cela entraîne. C'est enfin – et peut-être surtout – en termes de « travail »[86], de « production », de « marchandise », de « valeur »[87], etc. que la théorie parvient à implicitement légitimer son unité artificielle.
Ainsi, seule l'économie maintient la consistance du mirage de la « propriété intellectuelle ». Hors de ce champ, celle-ci vole en éclats. Richard Stallman ne dit pas autre chose dans l'article qui nous a servi de point de départ dans cette série de billets : Cette expression[…] amène les gens à se concentrer sur le peu que ces lois disparates ont en commun, du point de vue formel, à savoir qu'elles ont créé des privilèges artificiels pour certaines parties prenantes, et à ignorer les détails qui en font la substance, à savoir les restrictions spécifiques que chacune d'elles exerce sur le public, et les conséquences qui en résultent. Ceci favorise une approche purement économique de tous ces sujets. L'économie, comme souvent, opère comme un véhicule pour des hypothèses non validées.
Hélas, la science économique ne nous en apprendra que peu sur les justifications de la « propriété intellectuelle ». Tout au plus parvient-elle à réduire en poussière le premier pilier philosophique lockien, en constatant que celui-ci ne tient debout que pour justifier la propriété de biens rivaux – dont la consommation par un individu diminue la quantité disponible pour d'autres. Or, considérant que la « propriété intellectuelle » a pour objet la protection de marchandises issues de la production d'informations[88], de savoirs[89], de connaissances, d'idées[90], etc., force est de reconnaître que celles-ci sont des biens non rivaux[91].
Il n'en reste pas moins que la littérature économique les reconnaît comme biens, par conséquent marchandisables, et qu'elle s'accorde fort bien de cette contradiction soulevée à son niveau[92], comme de toutes celles que nous avons déjà pu relever sur d'autres plans[93]. Pourvu que la « propriété intellectuelle » pallie aux insuffisances du marché, dûes par exemple aux effets de parasitisme ou aux coûts de transaction[94], elle sera considérée par l'économie comme une donnée de base qu'il n'est pas utile de remettre en question. Dès lors, la « propriété intellectuelle » pourra sans problème être utilisée comme un objet économique ordinaire, que l'on rangera dans les actifs incorporels[95] pour le faire rentrer dans les bilans comptables[96].
Nous ne saurions en rester là ! Si la seule raison d'être du mirage de la « propriété intellectuelle » est d'ordre économique, il est nécessaire de nous interroger sur le sens, la nature et le rôle économiques de cet être fantasmagorique. Pour le dire autrement : quelle est la réalité économique que permet ce mirage de la « propriété intellectuelle » et qui est le seul mode par lequel elle existe effectivement réellement ? C'est à cette question que nous proposons de travailler dans le prochain billet.
Notes
[1] Richard M. Stallman, Vous avez dit « propriété intellectuelle » ? Un séduisant mirage.
[2] Cf. par exemple Mélanie Dulong de Rosnay, « Propriété intellectuelle », in La diversité culturelle à l'ère du numérique : glossaire critique, Divina Frau-Meigs, Alain Kiyindou, La Documentation Française, p. 250-253, 2014.
[3] Article 544 du code civil : La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
[4] Code de la propriété intellectuelle.
[5] Rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif au code de la propriété intellectuelle (partie législative), Par M. Jacques THYRAUD, Sénateur : Ce projet de loi a pour objet la simple codification de la législation actuelle en matière de droits d'auteurs, brevets, marques, dessins et modèles, obtentions végétales et droits voisins.
; Le projet de loi est le fruit des travaux de la nouvelle Commission supérieure de codification, créée par décret le 12 septembre 1989.
[6] Dossier Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992.
[7] Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992, parue au JO n° 153 du 3 juillet 1992, relative au code de la propriété intellectuelle (partie législative) : Article 1 – Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code de la propriété intellectuelle (partie Législative).
[8] Notons que le langage courant subit la même critique. Voir, par exemple, la définition claire et simple de la propriété, Dictionnaire historique de la Suisse, 24/09/2013 : La propriété désigne le pouvoir de détenir une chose corporelle (bien mobilier ou immobilier) ou incorporelle, d'en disposer et d'en jouir librement, dans les limites de la loi.
et celle plus alambiquée de la propriété intellectuelle, Dictionnaire historique de la Suisse, 12/04/2012 : Expression générique et juridiquement neutre servant à désigner la propriété de biens immatériels, soit un droit de possession, de disposition et d'utilisation d'œuvres de l'esprit, par opposition au terme simple de propriété, qui concerne les biens réels. Elle englobe aujourd'hui le droit d'auteur, les brevets, les dessins et modèles, les certificats d'obtention végétale et les marques de fabrique. Apparue à la fin du XVIIIe s., l'expression Geistiges Eigentum fut refusée par le droit allemand durant le XIXe s., car considérée comme non juridique, et remplacée par celles d'Urheberrecht (droit d'auteur) et Immaterialgüterrecht (droit de propriété immatérielle), avant de retrouver les honneurs après 1950 grâce à l'anglais Intellectual Property, courant dans le droit international.
[9] Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 sur la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information : 15. Considérant que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que, parmi ces derniers, figurent les droits de propriété intellectuelle et notamment le droit d'auteur et les droits voisins
.
[10] Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
[11] Déclaration de la Commission concernant l'article 2 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle (2005/295/CE) (je graisse) : La Commission considère que, au moins les droits de propriété intellectuelle suivants entrent dans le champ d'application de la directive : le droit d'auteur, les droits voisins, le droit sui generis d'un fabricant de base de données, les droits du créateur des topographies d'un produit semi-conducteur, les droits des marques, les droits des dessins et modèles, les droits des brevets, y compris les droits dérivés de certificats de protection supplémentaires, les indications géographiques, les droits en matière de modèles d'utilité, la protection des obtentions végétales, les dénominations commerciales, dans la mesure où elles sont protégées en tant que droits de propriété exclusifs par le droit national concerné.
[12] En l’occurrence dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : Article 17 – Droit de propriété – 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général. 2. La propriété intellectuelle est protégée.
[13] Explications du præsidium de la Convention relatives à la Charte des droits fondamentaux : La protection de la propriété intellectuelle, qui est un des aspects du droit de propriété, fait l'objet d'une mention explicite au paragraphe 2 en raison de son importance croissante et du droit communautaire dérivé.
[14] Accord commercial anti contrefaçon, ou ACTA d'après son acronyme anglais, entre l'Union européenne et ses États membres, l'Australie, le Canada, la Corée du sud, les États-Unis, le Japon, le Maroc, le Mexique, la Nouvelle Zélande, Singapour et la Suisse : un respect des droits de propriété intellectuelle efficace est essentiel pour assurer la croissance économique dans tous les secteurs d'activité et à l'échelle mondiale
; Chapitre sur la propriété intellectuelle de l'Accord de partenariat transpacifique, ou TPP d'après son acronyme anglais, entre l'Australie, Brunei, le Canada, le Chili, les États-Unis, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam (je traduis) : Renforce le rôle de la propriété intellectuelle dans la promotion du développement économique et social, particulièrement en relation avec la nouvelle économie numérique, l'innovation technique, [Pérou : la génération,] le transfert et la dissémination de la technologie et des échanges commerciaux ; réduit les entraves au commerce et à l'investissement en promouvant une intégration économique approfondie à travers la création, l'utilisation, la protection et le respect, efficaces et appropriées, de droits de propriétés intellectuelles, prenant en compte les différents niveaux de développement et de capacité économiques, ainsi que les différences dans les systèmes juridiques nationaux
; Accord économique et commercial global, ou CETA d'après son acronyme anglais, entre l'Union européenne et le Canada : Le présent chapitre a pour objet : a) de faciliter la production et la commercialisation de produits novateurs et créatifs, et la prestation de services entre les Parties ; b) d'assurer un niveau approprié et efficace de protection et d'application des droits de propriété intellectuelle.
; Position de l'Union européenne sur le chapitre « propriété intellectuelle » du Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, ou traité de libre-échange transatlantique, TTIP ou TAFTA d'après les acronymes anglais, entre l'UE et les États-Unis (je traduis) : Les droits de propriété intellectuelle (DPI) sont les des principaux moyens pour les entreprises, les créateurs et les inventeurs de générer des retours sur investissement dans la connaissance, l'innovation et la créativité
; Le but de cette introduction serait de sensibiliser sur l'importance du rôle de la PI afin d'encourager l'innovation et la créativité et, par conséquent, sa contribution essentielle à une croissance intelligente et durable
.
[15] ACTA, op. cit. : « propriété intellectuelle » désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections 1 à 7 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC
; TPP, op. cit. (je traduis) : La propriété intellectuelle se réfère à toutes les catégories de propriété intellectuelle qui sont l'objet des sections 1 à 7 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC [Australie/Pérou : Aux fins du présent chapitre, la “propriété intellectuelle” comprend également les droits sur les obtentions végétales]
; CETA, op. cit. : Pour l'application des articles 14 à 23, à moins de disposition contraire, l'expression “droits de propriété intellectuelle” s'entend de tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections 1 à 7 de la partie II de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
[16] Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ou Accord sur les ADPIC : Article premier – Nature et portée des obligations : 2. Aux fins du présent accord, l'expression “propriété intellectuelle” désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections 1 à 7 de la Partie II. […] PARTIE II – Normes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle : 1. Droit d'auteur et droits connexes […] 2. Marques de fabrique ou de commerce […] 3. Indications géographiques […] 4. Dessins et modèles industriels […] 5. Brevets […] 6. Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés […] 7. Protection des renseignements non divulgués
.
[17] Accord sur les ADPIC, op cit. : Article 7 – Objectifs : La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d'obligations.
[18] ADPIC : Qu'entend-on par droits de propriété intellectuelle ?, page d'information de l'OMC : Les droits de propriété intellectuelle sont les droits conférés à l'individu par une création intellectuelle. Ils donnent généralement au créateur un droit exclusif sur l'utilisation de sa création pendant une certaine période.
[19] Christopher May, La marchandisation à « l'âge de l'information » : droits de propriété intellectuelle, l'État et Internet [Commodifying the information age : intellectual property rights, the state and the internet], Actuel Marx 2/2003 (n° 34) , p. 81-97 : Les droits des capitalistes à muer information et savoir en marchandises comme bon leur semble sont privilégiés d'un bout à l'autre de l'accord, qui en fait des droits de propriété naturellement “justes”. […] Par conséquent, si l'accord lui-même consiste en un ensemble vaste et complexe de contraintes pour les signataires, il reste fondamentalement centré sur un dispositif de normes quant au traitement du savoir comme propriété. Ces normes gouvernent la totalité de l'accord en partant du principe que la jouissance privée du savoir comme propriété est moteur de développement économique et social. Elles favorisent le développement du savoir comme entreprise individuelle et sur la légitime récompense de ces efforts individualisés. L'ADPIC ne laisse pas le moindre doute quant à son exigence de marchandisation du savoir et de l'information.
. Cf. également Burch, K. (1995), Intellectual Property Rights and the Culture of Global Liberalism, Science Communication 17, n° 2 (December), 214-232 (je traduis) : Une extension d'une conception fondamentalement libérale de la vie sociale en tant que rapports organisés et perçus à travers le seul et unique prisme des droits de propriété … contribue à promouvoir le vocabulaire des droits et de la propriété ainsi que l'ensemble de la perspective conceptuelle libérale dont ils sont porteurs
.
[20] Susan Sell, Intellectual Property and Public Policy in Historical Perspective: Contestation and Settlement, 38 Loy. L.A. L. Rev. 267, 200 4 (je traduis) : Commentant les négociations réussies sur l'Accord sur le respect des droits de propriété intellectuelle qui touche au commerce (ADPIC) de 1994, l'un des participants a déclaré que les lobbyistes du secteur privé se sont vu accorder quatre-vingt-dix-neuf pourcents de ce qu'ils demandaient.
[21] Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (signée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979) Les Parties contractantes […] , afin d'encourager l'activité créatrice, promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde […] Article 2 Définitions viii) “propriété intellectuelle”, les droits relatifs : aux œuvres littéraires, artistiques et scientifiques, aux interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes exécutants, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion, aux inventions dans tous les domaines de l'activité humaine, aux découvertes scientifiques, aux dessins et modèles industriels, aux marques de fabrique, de commerce et de service, ainsi qu'aux noms commerciaux et dénominations commerciales, à la protection contre la concurrence déloyale ; et tous les autres droits afférents à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique.
[22] Actes de la conférence de Stockholm de la propriété intellectuelle, 11 juin au 14 juillet 1967, volume II, Rapport sur les travaux de la Commission principale N° V (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) par Joseph VOYAME, Rapporteur (Membre de la délégation de la Suisse), p. 1232, 1233 (p. 431, 432 du PDF) : IV. Nom de l'Organisation – 12. La Commission a été appelée à juger si l'Organisation serait appelée “internationale” ou “mondiale”. Elle a préféré ce dernier terme. En effet, une organisation internationale peut avoir une aire géographique étroite. Or, la nouvelle Organisation a une vocation universelle et, aujourd'hui déjà, les Unions comprennent la majorité des pays du monde et s'étendent sur les cinq continents. Il n'a donc pas paru trop prétentieux de choisir comme nom “Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle” (OMPI).
[23] Richard M. Stallman, op. cit., citant Mark A. Lemley, Property, Intellectual Property, and Free Riding, Texas Law Review, Vol. 83, p. 1031, 2005 (je traduis) : L'usage moderne du terme “propriété intellectuelle” en tant que descripteur commun du champ remonte certainement à l'institution de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) par les Nations unies. Voir la Convention établissant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, article 2 viii) (Stokholm, 14 juillet 1967). Depuis lors, de nombreux groupe comme l'American Patent Law Association [Association américaine du droit des brevets] et la section “brevets, marques de fabrique et droits d'auteur] de l'ABA [American Bar Association, Association américaine du barreau] ont été renommés (respectivement en American Intellectual Property Law Association [Association américaine du droit de la “propriété intellectuelle”] et section sur le droit de la “propriété intellectuelle” de l'ABA). La littérature a utilisé le terme bien avant cela, particulièrement sur le continent. Voir par exemple A. Nion, Droit civils des auteurs, artistes et inventeurs (1846) (se référant à la “propriété intellectuelle”) ; Davoll v. Brown, 7 F. Cas. 197, 199 (C.C.D.Mass. 1845) (appelant “propriété intellectuelle” les “travaux de l'esprit” et concluant qu'ils “appartienne autant à un homme… que ce qu'il cultive ou les troupeaux qu'il élève). Ces usages ne semblent cependant pas avoir reflété une approche unifiée basée sur la propriété des doctrines distinctes sur les brevets, les marques de fabrique ou les droits d'auteur.
[24] Voir par ex. : pour une critique incohérente de la « propriété intellectuelle » alors qu'elle ne porte que sur le copyright, qui plus est uniquement sur des œuvres littéraires, Clément Homs, Le droit de propriété intellectuelle ?… C'est le vol ! Proudhon, Victor Hugo, Orwell et quelques autres… ; pour une confusion entre « propriété intellectuelle » et brevets, Suzanne Scotchmer, The Political Economy Of Intellectual Property Treaties, National Bureau of Economic Research, Working Paper 9114, August 2012 ; pour une généralisation de la « propriété intellectuelle » sur le marché des idées à partir de la seule analyse des effets économiques des brevets et du copyright sur les œuvres de science-fiction, Michele Boldrin et David K. Levine, Growth and Intellectual Property, National Bureau of Economic Research, Working Paper 12769, December 2006 ; etc.
[25] Traités de l'OMPI – Informations générales – Principaux événements : 1883 - 2002, dont sont tirées les citations de ce paragraphe.
[26] Il semble cependant que le sigle BIRPI se soit tout d'abord rapporté à la propriété industrielle et non intellectuelle, cf. Justin Hughes, A Short History of Intellectual Property' in Relation to Copyright, July 11, 2009, 33 Cardozo Law Review 1293 (2012), Cardozo Legal Studies Research Paper No. 265 (je traduis) : Techniquement, chacun de ces deux bureaux [partageant globalement le même personnel] conservait une identité juridique séparée et les documents de réunion étaient rédigé en conséquence. L'acronyme complet des bureaux réunis aurait dû être BIRPILA – “Bureaux Internationaux Réunis pour la protection de la Propriété Industrielle, Littéraire et Artistique” et ce nom complet a été employé dans de nombreuses documentations à différents endroits dans l'histoire de l'organisation au 20 e siècle. Mais le nom étant tout autant, sinon davantage, raccourci à “bureaux réunis” ou BIRPI avec le dernier “I” pour “industrielle” (ou indéterminé).
[27] W.P. Blake et Henry Petit pour la Commission centenaire des États-Unis, Reports on the Vienna universal exhibition, 1873 (je traduis) : il est peut-être prématuré et imprudent d'étendre les délibérations au-delà du sujet du droit des brevets jusqu'aux beaux-arts et au droit des auteurs international
.
[28] Louis Donzel, Commentaire de la convention internationale, signée à Paris le 20 mars 1893 pour la protection de la propriété industrielle, applicable aux pays suivants : Belgique, Brésil, Espagne, États-Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Guatemala, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suède, Suisse, Tunisie, avec le texte de la Convention de 1883, du Protocole de clôture et des nouvelles propositions votées par la Conférence tenue à Madrid en avril 1890, Paris, Marchal & Billard, 1891, p. 123 : Une Union pour la protection de la propriété industrielle qui amalgamerait les brevets, les marques et les dessins, sans admettre que les dispositions relatives à une de ces trois branches de la propriété industrielle ne seraient applicables qu'aux citoyens ou sujets des États dont la législation reconnaît cette branche de la propriété industrielle, aurait l'inconvénient grave d'assurer en France des droits aux nationaux du pays qui n'en reconnaîtraient aucun aux Français. […] En ce qui concerne les dessins, comme en ce qui concerne les marques et les brevets, une Union ne serait pas seulement inutile : elle léserait gravement les intérêts français. […] Cette déclaration de principe indique bien la chimère qui hantait l'esprit des organisateurs du Congrès de 1878, et qu'il ne s'agissait de rien moins que d'une loi internationale sur la propriété industrielle, pour la rédaction de laquelle il restait sous-entendu que les nations rivaliseraient entre elles de générosité de désintéressement et d'abnégation. En procédant par voie d'union internationale, on rêvait de créer un enchevêtrement d'intérêts internationaux tel que la guerre ne serait plus possible, et que les nations seraient obligées d'être heureuses malgré elles. Le Congrès de Paris, disait un délégué Suisse, dans un accès de lyrisme international, sera le point de départ d'une période féconde dans la voie de cette entente entre les nations que nous sommes venus poursuivre de tous nos efforts et nous espérons ainsi assurer les bases de la paix et au bonheur du monde. Commencer à fonder le bonheur universel par une entente, au sujet de la durée des brevets, du montant des taxes, de l'examen ou du non examen préalable ! Pour procéder de cette façon il faut être, en vérité, bien convaincu qu'il y a commencement à tout. Ceux qui soulignèrent cette déclaration du délégué, suivie de leurs applaudissements, croyaient-ils tous travailler à la paix universelle ? Il est permis d'en douter. En gens avisés, ils savaient bien que leurs propositions concernant la déchéance des brevets, et la suppression de l'examen préalable des marques n'avanceraient pas d'une minute l'heure du désarmement général, qui ne sonnera à l'horloge du Temps, d'après une opinion très répandue, que quand il n'y aura plus personne ici-bas pour en profiter, ils se doutaient bien que ces propositions n'étaient pas de nature à décourager les chercheurs de fusils à répétition. Mais ils pouvaient apprécier que leur temps ne serait pas complètement perdu.
[29] Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979 : La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.
[30] Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979.
[31] Aeduki Fondation, Centre pour l'Éducation et la Sensibilisation à la Coopération Internationale, ''Découverte de la Coopération internationale, dossier n° 12 – Propriété intellectuelle : L'expression “propriété intellectuelle” concerne les créations de l'esprit humain, tout ce que son intelligence et son imagination lui ont permis de créer : œuvres artistiques, inventions, marques, emballages des produits que nous utilisons ou consommons. On distingue généralement la propriété littéraire et artistique appelée aussi droit d'auteur et droits connexes (ou voisins) et la propriété industrielle.
[32] Cf. Jacques Secretan, L'évolution structurelle des Unions internationales pour la protection de la propriété intellectuelle, in Les Unions internationales pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique – 1883-1963, Genève, 1962, qui passe sous silence la réunion des Bureaux de l'Union de Paris et de l'Union de Berne dans son analyse de la structure traditionnelle des Unions internationales pour la protection de la « propriété intellectuelle ».
[33] Actes de la conférence de Stockholm de la propriété intellectuelle, op. cit. p. 1230 (p. 429 du PDF) : Lorsqu'on créa, en 1883 et 1886, les Unions de Paris et de Berne, on les dota de secrétariats, dont les fonctions étaient du reste limitées : il s'agissait essentiellement de recueillir des renseignements, de procéder à des études dans le domaine de la propriété intellectuelle, de mettre le résultat de ces travaux à la disposition des membres des Unions et de préparer les Conférences de révision. Conformément aux usages de l'époque, un Gouvernement, en l'occurrence celui de la Confédération suisse, assuma la fonction de gérant des Conventions. En outre, les secrétariats furent placés sous son autorité et il fut chargé d'en régler l'organisation et d'en surveiller le fonctionnement. Le Gouvernement suisse, désireux que les services administratifs des Unions fonctionnent de façon aussi efficace et économique que possible, réunit par la suite les deux secrétariats, qui devinrent, dès lors, les “Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique” (BIRPI), placés sous l'autorité d'un seul Directeur. Cette situation s'est prolongée jusqu'à l'époque actuelle.
[34] L'origine de l'expression « propriété intellectuelle » est d'autant plus incertaine que le terme a également été utilisé pour désigner la seule « propriété littéraire et artistique », cf. Justin Hughes, op. cit. (je traduis) : dans la jurisprudence domestique française ou italienne propriété intellectuelle était souvent employée pour signifier simplement le droit d'auteur, avec toutefois des efforts notables pour pousser le terme jusqu'à son concept moderne englobant. La conclusion que propriété intellectuelle était généralement compris comme signifiant le droit d'auteur dans ces deux communautés juridiques se base sur les occurrences fréquentes dans les livres sur le droit d'auteur qui emploient propriété intellectuelle dans leurs titres, de façon à assumer que leurs lecteurs pertinents connaissaient le sens de l'expression (et en général toujours sans les mots droit d'auteur.) Il existe également des preuves de ce double sens pour propriété intellectuelle parmi les juristes de common law du 19e et du début du 20e siècle. Beaucoup plus important, propriété intellectuelle signifie sans ambiguïté droit d'auteur chez les juristes hispanophones car le droit d'auteur était expressément appelé “propiedad intellectual” en Espagne. […] Aux États-Unis, la plus ancienne décision rapportée avoir utilisé l'expression propriété intellectuelle semble être en 1845 dans l'affaire Davoll v. Brown [7 F. Cas. 197 (Circuit Court, D. Mass., 1845).], qui a employé l'expression en référence à un brevet. […] D'un autre côté, il existe de nombreuses occurrences au 19e et au début du 20e siècle de propriété intellectuelle dans laquelle l'auteur semble désigner le domaine du droit d'auteur. […] Un écho du droit d'auteur étant la “propriété intellectuelle” existe peut-être dans les nombreuses références dans le droit international du droit d'auteur aux œuvres sous droits d'auteur comme étant des “créations intellectuelles.”
. La notice anglaise Wikipédia reste ainsi très prudente : Le premier emploi connu du terme de propriété intellectuelle date de 1769, lorsqu'un article publié dans la Monthly Review a utilisé l'expression. Le premier exemple clair d'usage moderne remonte à 1808, quand elle a été employé comme titre dans une collection d'essais. L'équivalent allemand a été employé avec la fondation de la Confédération de l'Allemagne du Nord dont la constitution octroyait un pouvoir législatif sur la protection de la propriété intellectuelle (Schutz des geistigen Eigentums) à la confédération. Lorsque les secrétariats administratifs établis par la Convention de Paris (1883) et la Convention de Berne (1886) ont fusionné en 1893, ils se sont installés à Berne, et ont également adopté le terme de propriété intellectuelle dans leur nouveau titre combiné, les Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle. L'organisation a ensuite déménagé à Genève en 1960, et a été remplacée en 1967 avec l'établissement de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) par un traité, en tant qu'agence des Nations Unies. Selon Lemley, ce n'est qu'à partir de ce point que le terme a réellement commencé à être utilisé aux États-Unis (qui n'avaient pas participé à la Convention de Berne), et il n'est entré dans l'usage courant que lors du passage du Bayh-Dole Act en 1980. “L'histoire des brevets ne commence pas avec les inventions, mais plutôt avec les octrois royaux par la Reine Elizabeth I (1558-1603) de privilèges de monopoles… Approximativement 200 ans après la fin du règne d'Elizabeth, un brevet représente cependant un droit juridique obtenu par un inventeur, lui procurant un contrôle exclusif sur la production et la vente de son invention mécanique ou scientifique… [démontrant] l'évolution des brevets depuis les prérogatives royales à la doctrine coutûmière.” On peut trouver une utilisation du terme dans un jugement d'octobre 1845 du Massachusetts Circuit Court dans l'affaire Davoll et al. v. Brown. concernant un brevet, dans laquelle le juge Charles L. Woodbury a écrit que “nous pouvons protéger la propriété intellectuelle seulement de cette manière, les travaux de l'esprit, les productions et les intérêts sont propres à l'homme autant qu'on puisse l'être… comme le blé qu'il cultive, ou les troupeaux qu'il élève.” L'affirmation que les “découvertes sont… des propriétés” remonte plus tôt dans le passé. L'article 1 de la loi française de 1791 disposait que “Toute nouvelle découverte est la propriété de son auteur ; pour assurer à l'inventeur la propriété et la jouissance temporaire de sa découverte, un brevet doit lui être délivré pour cinq, dix ou quinze ans.” En Europe, l'auteur français A. Nion a mentionné “propriété intellectuelle” dans son Droits civils des auteurs, artistes et inventeurs, publié en 1846. Jusqu'à récemment, l'objectif des droits de propriété intellectuelle était de donner aussi peu de protection possible afin d'encourager l'innovation. Historiquement, par conséquent, ils étaient octroyés seulement lorsqu'ils étaient nécessaires pour encourager l'invention, limités dans le temps et dans leur portée. On peut retracer les origines du concept plus loin dans le temps. La loi juive comporte plusieurs considérations dont les effets sont similaires aux droits modernes de propriété intellectuelle, bien que la notion de créations intellectuelles en tant que propriété ne semble pas exister – notamment le principe de Hasagat Ge'vul (empiétement déloyal) était employé pour justifier un droit d'auteur limité dans le temps à l'éditeur (mais non à l'auteur) au 16e siècle. En 500 avant J.C., le gouvernement de l'état grec de Sybaris a offert un brevet d'un an “à tous ceux qui découvriraient tout nouveau raffinement dans le luxe”.
[35] Athénée de Naucratis, Deipnosophistes (Le Banquet des Sophistes), Livre XII, 20 (Traduction de Philippe Remacle revue et corrigée par Philippe Renault) : Dans le livre XXV de ses Histoires […] voici ce que dit encore Phylarchos [à propos des Sybarites] : “Si un cuisinier inventait de nouvelles et succulentes recettes, nul autre de ses confrères n'était autorisé à les mettre en pratique pendant une année, lui seul ayant le privilège de confectionner librement son plat : le but avoué de la chose était d'encourager les autres cuisiniers à se concurrencer dans la confection de mets toujours plus raffinés.”
[36] Christopher May, Venise : aux origines de la propriété intellectuelle , L'Économie politique 2/2002 (no 14) , p. 6-21 : nombre de préoccupations contemporaines étaient déjà présentes aux origines institutionnelles de la propriété intellectuelle, il y a cinq cents ans, à Venise. […] Aux XIVeet XVe siècles, la délivrance de brevets pour des monopoles, par opposition aux innovations, était en gros identique sur le continent et en Grande-Bretagne. Des concessions spécifiques semblables à l'octroi des privilegi à Venise n'étaient pas du tout inconnues, et on en trouve la trace dans les archives légales de nombreux pays. Mais le 19 mars 1474, Venise se singularisa lorsque le Sénat promulgua un décret où, pour la première fois, les brevets étaient soumis à une loi générale, plutôt qu'à un système de demande et d'accord individuels [Il y a dans cette cité et dans ses environs, attirés par son excellence et sa grandeur, de nombreux hommes de diverse origine, à l'esprit des plus inventifs et capables d'imaginer et de découvrir des machines variées et ingénieuses. S'il était stipulé que personne d'autre ne pourrait s'approprier leurs travaux pour accroître sa propre réputation ou fabriquer les machines imaginées par ces hommes, ces derniers exerceraient leur ingéniosité, et découvriraient et fabriqueraient des choses qui ne seraient pas d'un mince intérêt et d'un mince avantage pour notre État.]. […] On trouve en effet dans le texte vénitien de 1474 les grandes lignes du système moderne des brevets. Les points clés en sont : un équilibre entre le savoir rendu disponible par le biais d'un domaine public garanti par l'État, le droit pour l'inventeur de tirer bénéfice de son activité intellectuelle, et la notion de récompense de l'effort. Ce dernier point est l'un des principaux arguments auxquels ont recours ceux qui veulent légitimer la propriété (intellectuelle). Il est exprimé ici bien avant sa codification classique par John Locke au XVIIe siècle. […] le 14 novembre 1502, Alde[Alde Manuce, ou Aldo Manuzio, ou Aldus Manutius : Tebaldo Manuzio, né vers 1449, mort en 1515, premier d'une lignée d'imprimeurs humanistes et créateur du caractère italique (ou “aldine”) en 1501] obtint un monopole pour toutes les publications grecques et latines en italique, dans les limites de la juridiction de Venise. C'est la première fois, à notre connaissance, qu'un brevet était délivré pour un type de caractère plutôt que pour les œuvres qu'il servait à imprimer.[…] en 1518, les problèmes d'éditions contrefaites portant la marque d'Alde ne purent plus être ignorées […] Comme cela deviendrait habituel, la piraterie provoqua non seulement un discours sur le vol, mais aussi une justification de la propriété intellectuelle fondée sur la juste récompense du labeur : les pirates, incapables d'“égaler notre zèle dans la correction et dans l'impression, [ayant] recours à leurs artifices habituels”, avaient cherché à faire passer sous une marque honorablement connue des produits de qualité inférieure. […] les imprimeurs vénitiens travaillaient dans le cadre d'une structure de production capitaliste et, dans ce schéma organisationnel, garantir les droits de propriété sur le contenu intellectuel de leurs produits était de la plus haute importance. Dans la plupart des cas, les privilegi – et après 1474 les monopoles (ou quasi-brevets) - étaient accordés aux imprimeurs, et non aux auteurs. Mais ce n'était pas toujours le cas. […] C'est encore à Venise que fut prise la plus ancienne disposition formelle pour la protection d'un copyright totalement détaché des brevets accordés aux caractéristiques physiques du livre [décret publié par le Conseil des Dix, siégeant en 1544 et 1545]. […] Toutefois, même s'il est présenté dans des termes de principes universels, ce que révèle l'épisode vénitien est qu'à l'origine la propriété intellectuelle n'impliquait pas l'individu et ses droits, idéalisés, mais était plutôt une politique du gouvernement pour développer un avantage concurrentiel. Comme le montre le rôle des papetiers dans l'industrie naissante de l'imprimerie, les idées centrales de la propriété intellectuelle ont été largement développées dans les corporations, c'est-à-dire dans le secteur privé, avant d'être adoptées par les autorités juridiques.
[37] Venetian Statute on Industrial Brevets, Venice (1474), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer.
[38] Venetian Decree on Author-Printer Relations, Venice (1545), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer.
[39] David Paul A., National Academy Press, Translatel, Le compromis du système d'organisation de la production intellectuelle, In: Réseaux, 1998, volume 16 n°88-89. p. 55, 56 : Comme les tout premiers brevets d'inventions, les premiers droits d'auteur sont apparus à la Renaissance italienne. L'imprimerie apparut à Rome et à Venise aux alentours de 1470. Avec l'octroi, dans les années 1469-1517, d'une série de privilèges relatifs à des livres et à l'imprimerie par le Cabinet, le Sénat et autres organes gouvernementaux, Venise prit rapidement la tête de cette nouvelle technologie en Italie. Ces privilegi incluaient des franchises d'importation, dont la première (1469), comme nous l'avons mentionné, accorda à l'imprimeur allemand, Johann von Speyer, le privilège exclusif de diriger toutes les activités d'impression dans la cité pendant cinq ans, en échange de l'introduction de cet art. Vinrent, peu de temps après, l'octroi de monopoles sous forme de licences exclusives d'imprimer et de vendre toute une catégorie de livres pendant une période stipulée, ainsi que l'interdiction d'importer des livres imprimés à l'étranger et les brevets destinés à améliorer l'impression et la typographie. La question des droits d'auteur était largement négligée parce qu'une grande partie de la demande concernait des ouvrages déjà existants (comme la Bible) qui étaient du domaine public et dont les auteurs, même s'ils étaient connus, étaient morts depuis longtemps. Vers la fin du siècle, cependant, certains privilèges, qui avaient effectivement le caractère de droits d'auteur modernes, furent octroyés pour la protection des auteurs : en 1486, on accorda à l'historiographe de la République le contrôle exclusif de la publication de son œuvre. En 1493, le Cabinet vénitien accorda à Daniele Barbaro des droits de propriété exclusifs de 10 ans sur la publication d'un livre écrit par son frère défunt. Plus typiques étaient les droits d'auteur accordés à des rédacteurs et éditeurs pour des ouvrages individuels écrits par d'autres. Il s'agissait de monopoles insignifiants interdisant la publication de l'ouvrage sans la permission du bénéficiaire du privilège. Les éditeurs vinrent bientôt en masse voir le gouvernement pour se réserver des titres bien connus, dans l'espoir soit de les publier eux-mêmes, soit de vendre ultérieurement le droit à un autre imprimeur. En 1517, la pénurie consécutive de titres disponibles fit que le Sénat limita désormais ces privilegi de droits d'auteur aux “ouvrages nouveaux et non imprimés antérieurement”. Ce qui fut probablement la première loi générale sur les droits d'auteur du monde apparut sous forme de décret promulgué par le Conseil des Dix de Venise (1544- 1545). Celui-ci interdisait l'impression de tout ouvrage, à moins que la permission écrite de l'auteur ou de son héritier immédiat n'ait été remise aux membres de la commission de l'Université de Padoue. Rien n'était cependant stipulé concernant la tenue d'un registre des ouvrages protégés. Ce décret fut promulgué parce qu'on continuait à imprimer sans autorisation des ouvrages pour lesquels des droits d'auteur avaient été accordés. Une mesure supplémentaire visant à réglementer de manière plus complète l'imprimerie fut prise en 1548-1549, avec l'adoption par le Conseil d'un décret établissant une corporation dans laquelle devaient se regrouper tous les imprimeurs et éditeurs de Venise. L'une des raisons supplémentaire de cette action était d'aider l'Église à supprimer toute littérature hérétique.
[40] Capitalisme (notion de) dans l'Encyclopædia Universalis : Le capitalisme est ancien et n'a cessé d'évoluer. Il s'est développé en trois grandes étapes. Tout d'abord, le capitalisme commercial lié aux grandes découvertes techniques (l'imprimerie) et géographiques (le Nouveau Monde) qui ouvrent, à partir du XVIe siècle, de nouvelles voies commerciales, sans oublier la révolution des idées représentée par la Renaissance : la richesse, suspecte au Moyen Âge, est désormais justifiée et honorée.
[41] Pierre-Emmanuel Moyse, La nature du droit d'auteur : droit de propriété ou monopole ?, McGill Law Journal, Vol. 43, No. 2, 1998 : adoption, le 10 avril 1710, de la loi d'Anne qui – et c'est ici son titre honorifique – doit être considérée comme l'an un du droit positif en matière de droit d'auteur. Le titre de la loi est très explicite : “An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies, During the Times therein Mentioned”. Il n'est donc pas fait allusion à une quelconque propriété. Le choix des mots n'est jamais arbitraire quand il émane de la plume d'un juriste. […] La question se résume à savoir si le droit d'auteur est un monopole ou un droit de propriété ? Alors que le droit de propriété repose classiquement sur l'idée d'un droit naturel, ce qui, par là-même, lui confère son caractère absolu et perpétuel, le monopole fait référence à des considérations de politique législative. En common law on parle alors d'un statutory right. La notion de monopole semble plus synthétique : du fait de son orientation économique elle parait neutre, précise, et plus teintée d'un pragmatisme moderne. C'est, en d'autres termes, la version désacralisée de la propriété. Nous ne voyons en fait entre ces deux termes qu'une différence de degrés. Cette notion de monopole a été taillée par l'évolution des technologies, à la mesure des sociétés capitalistes. Ce n'est donc pas un hasard si c'est en Angleterre, première de toutes les nations industrialisées, que la notion de monopole fit ses premières armes. […] L'Angleterre du XVIIIe siècle pouvait s'enorgueillir d'une avance industrielle considérable sur le reste des pays européens. Quelque temps avant l'adoption de la loi d'Anne, le Statute of Monopolies fut arraché au roi Jacques Ier d'Angleterre en 1623. Il s'agit là de la première réglementation relative aux brevets d'invention. L'adoption de ces normes est très révélatrice de l'état de la société anglaise, à l'aube de la révolution industrielle. Il est incontestable qu'à un ordre économique naissant, de style capitaliste, doit répondre une régularisation juridique adéquate. L'histoire des idées politiques et économiques nous peint le climat juridique dans lequel les droits, et notamment les droits intellectuels, vont prendre naissance. Les différentes phases de l'évolution du copyright stigmatisent bien, à notre avis, les périodes charnières du capitalisme et de son influence sur l'orientation du droit.[…] Si effectivement la loi consacrait un droit subjectif au profit de l'auteur, il fallait que ce dernier fut assez flexible pour favoriser la croissance de l'économie. L'auteur de la loi d'Anne avait donc créé une fiction juridique qui empêchait l'auteur de venir contrarier l'exercice des droits des éditeurs. La seule liberté de fait qui lui était laissée était celle de choisir son éditeur. Derrière les mots, c'était finalement un droit résiduel qui était ainsi consacré. Une fois la propriété de son manuscrit transférée, il cédait tout pouvoir sur son œuvre. […] Plus avant dans ces théories, les économistes distingueront la valeur d'échange de la valeur d'usage. La valeur d'usage se confond à peu près avec l'utilité ; elle est subjective et exprime le rapport qui existe entre les objets et nos désirs. La valeur d'échange tend à s'incarner dans le prix qui l'objective socialement. […] Toutes ces précisions économiques tendent à montrer que très tôt les penseurs anglais se sont rendus sans détours à l'évidence : le talent de l'artiste fait tourner les rouages de l'imprimerie. Le système du copyright permet la rémunération des artistes dans le respect du principe supérieur de l'amortissement des coûts de production des copies de son œuvre. En définitive, l'histoire du copyright nous révèle deux choses qui pouvaient sembler contradictoires a priori. D'abord, l'auteur a un droit de propriété, mais seulement en ce qu'il est inféré des principes philosophiques de l'époque ; le rattachement au droit naturel est moins pressant. Il justifie seulement, et dans un premier temps, l'existence du droit d'auteur ; il n'influence que très peu le régime du droit. C'est d'ailleurs pour cela que l'on parle de copyright. Il aurait été de toute manière délicat de concéder ce droit à l'éditeur, qui n'est pas le géniteur de l'œuvre. Ensuite, la seconde nature de ce droit résulte, selon les propos de Gary Kauffman, d'un “accident” historique. C'est pour mettre fin au monopole sur le commerce du livre que, déjà en 1694, la Chambre des Communes refusa de renouveler le “Licensing Act”. La loi de 1709 apparaît donc comme un instrument de démantèlement qui confond les deux types de monopole dont nous avons parlé : le monopole incontesté de l'auteur sur son œuvre et le monopole des éditeurs sur le commerce.
[42] Statute of Monopolies, 1623 Chapter 3 21 Ja 1.
[43] The Statute of Anne, April 10, 1710, An act for the encouragement of learning, by vesting the copies of printed books in the authors or purchasers of such copies, during the times therein mentioned.
[44] Ludovic Hennebel, Propriété intellectuelle versus « communisme informationnel » : En Angleterre, les discussions portant sur le droit d'auteur prennent une autre direction. Le droit d'auteur y est consacré en droit positif par la loi Anne de 1710, intitulée An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies, During the Times therein Mentioned. Il n'y est pas fait allusion à la notion de propriété : la loi Anne consacre un droit subjectif au profit de l'auteur. Cependant, à l'aube de la révolution industrielle, les juristes anglais estimaient que ce droit ne pouvait entraver la croissance économique. L'auteur avait donc la liberté de choisir son éditeur, mais dès qu'il cédait son œuvre, l'éditeur se subrogeait à lui dans la totalité de ses droits. Cette législation a permis de briser les privilèges anglais en matière d'édition. Toutefois, ce revirement se justifie uniquement par des impératifs économiques : le monopole légal attribué à l'imprimeur vise à compenser les coûts de production et les investissements nécessaires à la fabrication et à la distribution de l'œuvre. Ainsi, en Angleterre, si la propriété permet de justifier l'attribution de droits à l'auteur sur le produit de son travail, dès que ce dernier cède son œuvre à l'éditeur en vue de la publier, celui-ci devient titulaire d'un copyright. Ce « droit de copie » est un monopole légal d'exploitation qui est donc justifié non pas par les règles du régime de la propriété privée ordinaire mais uniquement par les conditions du marché de l'édition. Les théories personnalistes continentales n'ont pas eu leur équivalence anglaise, les juristes anglais semblant se désintéresser de la question et se concentrer sur les nécessités de réguler le marché. Cette perspective historique nous éclaire sur les contenus respectifs du droit d'auteur et du copyright anglo-saxon contemporains. Le droit d'auteur d'Europe continentale est un droit naturaliste basé sur l'idée d'une propriété naturelle qui s'applique automatiquement à toute œuvre de l'esprit pour autant qu'elle soit originale et exprimée sous une certaine forme. Il vise à protéger la créativité et la personnalité de l'auteur et se justifie par des considérations principalement morales, où l'intérêt privé du créateur prime sur l'intérêt général. Le droit d'auteur comprend en outre, des prérogatives économiques et offre une protection exclusive de longue durée au créateur - personne physique - calculée à partir de la mort de ce dernier. Par contre, le copyright anglo-saxon est un droit positif exercé sous la forme d'un monopole légal et justifié par des considérations purement économiques. Il entend protéger le travail et l'habileté de l'entrepreneur - personne morale ou personne physique - en lui accordant des prérogatives exclusivement économiques. La durée de protection est courte et calculée à partir de la date de publication de l'œuvre. En outre, certaines formalités conditionnent cette protection.
[45] Ronan Deazley, On the Origin of the Right to Copy: Charting the Movement of Copyright Law in Eighteenth Century Britain (1695-1775), Bloomsbury Publishing, 31 juil. 2004, p. 41 (je traduis) : Cependant ce qui débuta comme un projet de loi “pour garantir la propriété des copies de livres” devint un projet “pour encourager l'apprentissage, en conférant les copies de livres imprimés aux auteurs et aux acquéreurs de telles copies”. […] Toutefois, toute cette rhétorique et cette justification allant de soi concernant la “propriété indubitable” des auteurs sur leurs œuvres ont été ensuite supprimées. Comme avec le titre du projet, la longueur et la signification du préambule ont été réduites, le confinant à la prévention du piratage et de “l'encouragement des hommes instruits à composer et écrire des livres utiles”.
[46] Gabriel Galvez-Behar, Si loin, si proches. Inventeurs et artistes au regard de la propriété intellectuelle dans la France du XIXe siècle, Les mythes de la science : inventeurs et invention, Colloque organisé par la MSH-Nord-Pas-de-Calais, Dec 2005, France <halshs-00008326> : Selon cette acception, la propriété industrielle (celle qui se rapporte aux brevets d'invention, aux marques, aux dessins et modèles) et la propriété littéraire et artistique ne sont que deux espèces d'un même genre, la propriété intellectuelle. D'un point de vue historique, ces deux notions revêtent bel et bien un air de famille car elles s'épanouissent, pour ainsi dire, avec la Révolution française.
[47] Pierre-Emmanuel Moyse, op. cit. : Le jurisconsulte français parlera, d'une véritable propriété, mais ses mots sont teintés d'un romantisme et d'une gravité proprement français.
[48] Rapport fait à l'Assemblée nationale par M. Stanislas-Jean de Boufflers, au nom du Comité d'agriculture et de commerce, dans la séance du jeudi au soir 30 décembre 1790, sur la propriété des auteurs de nouvelles découvertes & inventions en tout genre d'industrie : S'il existe pour un homme une véritable propriété c'est sa pensée ; celle-là du moins paraît hors d'atteinte, elle est personnelle, elle est indépendante, elle est antérieure à toutes les transactions ; et l'arbre qui naît dans un champ n'appartient pas aussi incontestablement au maître de ce champ, que l'idée qui vient dans l'esprit d'un homme n'appartient à son auteur. L'invention, qui est la source des arts, est encore celle de la propriété ; elle est la propriété primitive, toutes les autres ne sont que des conventions ; et ce qui rapproche et ce qui distingue en même temps ces deux genres de propriété, c'est que les unes sont des concessions de la société, et que l'autre est une véritable concession de la nature ; peut-être même la seule étymologie du mot suffirait-elle [Le mot propriété signifie le partage du premier. Il faudrait bien peu connaître l'organisation de la langue latine pour ne pas voir que le mot proprietas est formé de la particule pro et pri syllabe radicale des mots qui désignent la primauté. L'étymologie des mots, alors qu'elle est incontestable est en général d'une grande ressource pour leur définition. Elle a éclairci plus d'un doute ; et dans la plupart des questions de ce genre, nous n'avons pas de meilleur parti à prendre que de nous en rapporter au grand sens des premiers inventeurs du langage.] pour nous prouver que dans l'origine des choses la propriété a été regardée comme le partage du premier, et par conséquent comme le droit de l'inventeur. Tant qu'un inventeur n'a pas dit son secret, il en est le maître, et rien ne l'empêche, ou de le tenir caché, ou de fixer les conditions auxquelles il consent de le révéler. Il est libre en contractant avec la société comme la société en contractant avec lui : le contrat une fois passé, elle est engagée envers lui comme il est engagé envers elle ; et tant qu'il est fidèle à ses engagements, elle ne lui doit pas moins de protection dans les moyens qu'il prend pour le développement de sa nouvelle idée, qu'elle ne lui en accorderait pour l'exploitation de son patrimoine. C'est d'après ces premières notions qu'en ce moment les auteurs de plusieurs nouvelles découvertes, (soit qu'ils les aient déjà fait connaître au public, soit qu'ils en diffèrent encore la manifestation) demandent seulement que ce genre de propriété leur soit garanti par le corps social, afin d'être défendus contre tous les préjugés et tous les intérêts privés qui pourraient tenter de les troubler, de les supplanter ou de les rivaliser dans l'exercice de leurs droits les plus sacrés ; et leur ambition se borne à percevoir exclusivement les fruits d'une faveur que la nature leur a faite exclusivement. […] Article premier – Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur ; en conséquence, la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminés.
[49] Archives parlementaires, Tome 22 : Du 3 janvier au 5 février 1791, Séance du jeudi 13 janvier 1791, au soir, page 212. Rapport du comité de Constitution sur la pétition des auteurs dramatiques, M. Le Chapelier : Les comédiens français, après avoir longtemps, à l'aide d'un privilège exclusif, subjugué les auteurs dramatiques, et par un étrange renversement dans l'ordre des choses, les avoir rendus leurs tributaires, sont devenus leurs adversaires, quand ceux-ci ont réclamé les droits que venait de leur rendre une Constitution libre ; pour prendre ce rôle, ils n'ont eu qu'un changement de mots à faire, ils ont appelé propriété leur privilège. […] La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable et, si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés, est l'ouvrage, fruit de la pensée d'un écrivain ; cependant c'est une propriété d'un genre tout différent des autres propriétés. Quand un auteur a livré son ouvrage au public, quand cet ouvrage est dans les mains de tout le monde, que tous les hommes instruits le connaissent, qu'ils se sont emparés des beautés qu'il contient, qu'ils ont confié à leur mémoire les traits les plus heureux ; il semble que dès ce moment l'écrivain a associé le public à sa propriété, ou plutôt la leur a transmise tout entière ; cependant, comme il est extrêmement juste que les hommes qui cultivent le domaine de la pensée tirent quelque fruit de leur travail, il faut que, pendant toute leur vie et quelques années après leur mort, personne ne puisse, sans leur consentement, disposer du produit de leur génie. Mais aussi, après le délai fixé, la propriété du public commence, et tout le monde doit pouvoir imprimer, publier les ouvrages qui ont contribué à éclairer l'esprit humain. […] Art. 5 – Les héritiers ou les cessionnaires des auteurs seront propriétaires de leurs ouvrages, durant l'espace de cinq années, après la mort de l'auteur.
[50] Archives parlementaires, Tome 69 : Du 15 janvier au 29 juillet 1793, Séance du vendredi 19 juillet 1793, page 186. Lakanal, au nom du comité d'instruction publique fait un rapport et présente un projet de décret sur la propriété littéraire et artistique : Citoyens, de toutes les propriétés, la moins susceptible de contestation, celle dont l'accroissement ne peut ni blesser l'égalité républicaine, ni donner d'ombrage à la liberté, c'est sans contredit celle des productions du génie ; et si quelque chose doit étonner, c'est qu'il ait fallu reconnaître cette propriété, assurer son libre exercice par une loi positive ; c'est qu'une aussi grande révolution que la nôtre ait été nécessaire pour nous ramener sur ce point, comme sur tant d'autres, aux simples éléments de la justice la plus commune. Le génie a-t-il ordonné, dans le silence, un ouvrage qui recule les bornes des connaissances humaines : des pirates littéraires s'en emparent aussitôt, et l'auteur ne marche à l'immortalité qu'à travers les horreurs de la misère. Eh ! ses enfants !… Citoyens, la postérité du grand Corneille s'est éteinte dans l'indigence !… L'impression peut d'autant moins faire des productions d'un écrivain une propriété publique, dans le sens où les corsaires littéraires l'entendent, que l'exercice utile de la propriété de l'auteur ne pouvant se faire que par ce moyen, il s'ensuivrait qu'il ne pourrait en user, sans la perdre à l'instant même. Par quelle fatalité faudrait-il que l'homme de génie, qui consacre ses veilles à l'instruction de ses concitoyens, n'eût à se promettre qu'une gloire stérile, et ne pût revendiquer le tribut légitime d'un si noble travail. C'est après une délibération réfléchie que votre comité vous propose de consacrer des dispositions législatives qui forment, en quelque sorte, la déclaration des droits du génie. […] Art. 1er – Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie.
[51] Arrest du Conseil d'Etat du Roi, portant Règlement sur la durée des Privilèges en Librairie, 30 août 1777 : Dans l'histoire du droit des brevets et de la propriété littéraire, la deuxième partie du XVIIIe siècle s'est avérée décisive, en ce sens qu'elle a permis, à travers la législation royale, de fixer et façonner, avant même la Révolution, le visage des deux matières. Dans la première, la déclaration du 24 décembre 1762 réglementait les règles d'octroi des privilèges exclusifs, en en limitant la durée de manière drastique et en la conditionnant clairement à l'utilité publique. Dans la seconde, la législation du 30 août 1777 sur la librairie et l'imprimerie, dont le principal arrêt, ici reproduit, concernait la durée des privilèges, reconnaissait le droit spécifique de l'auteur sur son travail, tout en mettant un terme à la confrontation corporative qui opposait libraires (et imprimeurs) parisiens à leurs homologues de province. […] Avant la Révolution, et l'importance qu'elle donnera à la propriété, la nature propre aux privilèges avait finalement permis de reconnaître celle de l'auteur sur sa création, tout en brisant simultanément les monopoles des libraires parisiens.
[52] Déclaration du Roy, concernant les privilèges en fait de commerce, du 24 décembre 1762 La distinction entre œuvre et invention, entérinée dans les ultimes législations de 1762 et 1777, s'expliquera aisément pour les partisans de la notion de propriété littéraire. Au-delà de la question de l'utilité publique ou de l'intérêt national dans le degré de protection de ces deux productions de l'esprit, c'est bien en effet leur nature profonde qui diffère. Pour Simon Linguet, par exemple, “la composition d'un livre, quel qu'il soit, est une véritable création : le manuscrit est une partie de SA substance que l'écrivain produit au-dehors” [Simon Linguet, Annales politiques, civiles, et littéraire du XVIIIe siècle, tome III, Londres, 1777, p. 31 (reprise en partie de son mémoire antérieur de 1774, Mémoire sur les propriétés et privilèges exclusifs de la librairie). ]. L'objet de la propriété littéraire ne peut constituer de ce fait un monopole qui s'exercerait sur l'ensemble du champ littéraire. Il n'est ni tributaire de la simple nouveauté d'une idée, ou encore d'une habile technique, si louable et si utile soit-elle, par exemple la production d'un mécanicien “confectionnant une machine inconnue”. Le travail de l'écrivain, indépendamment de sa légitimité - ou même de sa rentabilité -, sort “du cerveau de l'auteur aussi parfait qu'il peut l'être…”. C'est bien parce que le monopole ne porte pas sur l'idée, mais sur la manière de la traiter, que si l'ouvrage est “susceptible de quelques degrés d'amélioration, ce n'est que de la main paternelle qu'il peut les recevoir” [Simon Linguet, op. cit., p. 23-24. À la même époque, en 1777, l'abbé Pluquet rappelait en effet que l'auteur qui compose un livre en est bien propriétaire, “sinon pour la matière, au moins par la manière de la traiter” (François-André-Adrien Pluquet, Troisième lettre à un ami concernant les affaires de la librairie, reproduit dans Laboulaye et Guiffrey, La propriété littéraire au XVIIIe siècle, Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1859, p. 334-335).]. Par contraste, l'invention peut toujours être améliorée et ce qui n'a pas été découvert par l'un l'aurait été forcément par l'autre. Pour résumer, au travail objectivement quantifiable par sa nouveauté, on oppose déjà le caractère éminemment personnel de la relation auteur / œuvre, la seule susceptible de justifier alors pleinement la qualification libérale du droit de propriété. Le caractère objectif du critère de “nouveauté”, déjà formulé en 1762, reste d'ailleurs toujours essentiel en droit positif de la propriété industrielle. Rappelons enfin qu'en Angleterre, toujours au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, cette distinction fut tout aussi élémentaire [Voir par exemple F. Hargrave, An Argument in Defence of Literary Property, London, 1774, p. 36-37, qui rappelait que la relation entre l'inventeur d'une machine et l'auteur d'un livre n'était qu'apparente (je traduis) : “Selon ma propre opinion, la distinction principale est, que dans un cas, la revendication est clairement l'appropriation de l’usage des idées ; mais dans l’autre, la revendication réside dans l’usage des idées communes au monde entier”.].
[53] Gabriel Galvez-Behar, op. cit. : Soldat, gouverneur de Saint-Louis du Sénégal mais aussi poète, ami de Voltaire, Stanislas de Boufflers entra à l'Académie française en 1788 et devint député de la noblesse du bailliage de Nancy un an plus tard. C'est en véritable homme des Lumières qu'il présente son rapport le 30 décembre 1790 à l'Assemblée nationale. Largement inspiré par un groupe d'inventeurs, le rapport de Boufflers défend ainsi l'idée que tous les arts trouvent leur source dans l'invention mais aussi que la pensée est l'essence même de la propriété. […] Le rapport de Boufflers devant l'Assemblée nationale est essentiel car il cristallise des arguments-clefs repris par les partisans de la propriété littéraire et artistique . En effet, le combat pour la propriété des “fruits de la pensée” est au même moment poursuivi par les auteurs, à commencer par les auteurs dramatiques. En effet, ces derniers déposèrent à leur tour en août 1790 une pétition auprès de l'Assemblée nationale afin que l'on reconnaisse la propriété des auteurs dramatiques sur leurs œuvres et exigeant que le droit de représentation ne fût pas soumis à un privilège. Cette pétition donna lieu à un rapport présenté par l'avocat et député rennais Isaac-René Le Chapelier, le 13 janvier 1791, fondé sur un raisonnement en bien des points identique à celui de Boufflers. […] Aussi est-on en droit de penser que la loi du 13 janvier 1791 sur les droits de l'inventeur a incité l'ensemble des auteurs à obtenir la reconnaissance de leurs propres droits. Il faut toutefois attendre le 28 septembre 1791 pour voir la question de la propriété littéraire revenir sur le devant de la scène. Le député du Bas-Rhin, François-Joseph-Antoine Hell, présente alors un rapport sur la propriété des productions scientifiques ou littéraires qui s'inspire à nouveau très largement de celui de Boufflers. […] Bien que les mots du représentant du Bas-Rhin fussent quasiment identiques à ceux de Boufflers, ils ne produisirent cependant pas le même effet puisque l'Assemblée, loin d'adopter une loi nouvelle, décida d'ajourner l'examen de sa proposition de décret à la législature suivante. La question revint de manière inopinée devant la Convention en juillet 1793, après que plusieurs écrivains se furent plaint que leurs pétitions fussent restées sans réponse. C'est à Lakanal qu'échut la tâche de présenter précipitamment un projet de décret sur “la propriété littéraire et artistique” le 19 juillet 1793. Son rapport est également la reprise mot pour mot d'un rapport que Baudin, député des Ardennes, avait rédigé en faveur des auteurs dramatiques. Là encore, la propriété des “productions du génie” y est décrite comme une propriété incontestable. Sans discussion, la Convention vota la loi conférant aux auteurs un droit exclusif d'exploitation de leurs œuvres pendant toute leur vie et à leurs héritiers pendant dix ans.
[54] Mémoire de Louis d'Héricourt à Monseigneur le Garde des Sceaux, Bibliothèque nationale de France, 1725-1726 : Si les productions littéraires tiennent le premier rang entre toutes celles dont les hommes sont capables par rapport aux avantages qu'ils en tirent, elles doivent se communiquer pour l'intérêt commun. Si elles doivent se communiquer, il faut que les Auteurs les puissent faire passer à d'autres par le canal de la vente ou de l'échange ; donc les productions littéraires sont au nombre des choses qui tombent dans le Commerce, comme les autres productions de l'industrie ; et par une conséquence nécessaire les Lois du Royaume, auxquelles le Commerce et l'industrie ont donné lieu pour assurer l'état des conventions des Citoyens, doivent être singulièrement appliquées à celles qui se font entre les Auteurs et les Libraires. Or, il n'est pas douteux, aux termes des Lois, que le propriétaire d'une chose, en la faisant passer à un autre par le canal de la vente et de l'échange, transmet au nouveau possesseur les mêmes droits qu'il avait sur la chose dont il se dépouille. On a fait voir que l'Auteur d'un Ouvrage en était tellement le maître, qu'il ne pouvait en être dépouillé sans injustice ; que ce même Ouvrage, fruit de son intelligence, tombait naturellement dans le Commerce comme les autres productions de l'industrie ; enfin que ceux à qui il jugeait à propos de le faire passer, acquéraient dans l'instant tous ses droits sur la chose qu'il leur transmettait ; donc, un Libraire qui a acquis un Manuscrit, dans lequel il ne s'est rien trouvé de contraire à la Religion, aux Lois de l'État, ou à l'intérêt des Particuliers ; qui a enfin obtenu un Privilège pour l'imprimer doit demeurer perpétuellement propriétaire du Texte de cet Ouvrage, lui et ses descendants, comme d'une terre ou d'une maison qu'il aurait acquise, parce que l'acquisition d'un héritage ne diffère en rien par la nature de l'acquisition de celle d'un Manuscrit, mais seulement par les suites de l'acquisition du Manuscrit, dont les risques sont considérables, au lieu que dans celle d'une terre, après que l'acquéreur a pris les précautions convenables pour se mettre à couvert des hypothèques ou de l'éviction, il ne court plus aucun risque : mais quant à la nature de l'acquisition de ces deux choses, elle est précisément la même, et par conséquent elles doivent avoir un sort au moins égal.
[55] Eugène Pouillet, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres, 6e éd. entièrement refondue et mise au courant de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence, Paris, Marchal et Billard, 1912. Loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce. Titre 1er. Du droit de propriété des marques.
; Eugène Pouillet, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres, 2e éd., Paris, Marchal et Billard, 1883, citant le rapport fait au nom de la commission, composée de MM. Réveil, président ; Busson, rapporteur, Monnin-Japy, Perret, Riche, Quesné, Levavasseur, chargée d'examiner le projet de loi relatif aux marques de fabrique et de commerce : Messieurs, le projet de loi dont vous nous avez confié l'examen est la réalisation de voeux incessamment exprimés par les représentants de l'industrie et du commerce, qui le réclament comme une protection nécessaire et un véritable bienfait. Aussi votre Commission vous eût-elle soumis son travail dès la session dernière, si elle n'eût été amenée à l'ajourner par la pensée même de mieux servir les intérêts qui s'y trouvent engagés. Divers projets de lois sur les brevets d'invention, les dessins de fabrique, étaient à l'étude, et il y avait avantage, suivant nous, à les réunir dans le même examen et la même délibération. Régir par les mêmes principes des matières identiques, tout au moins connexes, donner à la loi le caractère si désirable d'harmonie et de simplicité, tel était notre désir, favorablement accueilli par le Gouvernement, jaloux de donner à l'industrie, qui le demande si vivement, son code civil. L'étude de ces projets paraît avoir soulevé des difficultés qui en retardent la présentation, et nous avons dû reprendre l'examen de la loi spéciale que vous nous avez renvoyée. Nous avons, d'ailleurs, la ferme confiance que le Gouvernement n'abandonnera pas la pensée qu'il avait paru partager, et dont la réalisation serait pour l'industrie et le commerce une amélioration considérable ; nous l'attendons de ses intentions libérales et sagement progressives. […] La marque est le signe de la personnalité du fabricant, du commerçant, imprimée à leurs produits ; elle constitue donc une véritable propriété que proclame l'intitulé même de ce titre, et qui est le premier mot de la loi. Mais cette manifestation de sa personnalité par l'industriel ou le commerçant doit-elle rester libre ? doit-elle, au contraire, être une obligation légale ? En un mot, la marque doit-elle être obligatoire ou seulement facultative ? Telle est, Messieurs, la grave question que soulève toute loi sur les marques, qu'ont agitée, les organes de l'industrie, qui partage les chambres de commerce, et qu'il fallait résoudre dès le début de la loi.
[56] Valérie Marchal, Brevets, marques, dessins et modèles. Évolution des protections de propriété industrielle au XIXe siècle en France, Documents pour l'histoire des techniques, 17, 1er semestre 2009 : Si les auteurs d'inventions et découvertes techniques, comme les auteurs d'œuvres écrites (artistes et compositeurs de musique) [Décret-loi du 19 juillet 1793], obtiennent satisfaction, leurs revendications coïncidant parfaitement avec les idéaux de la Révolution, les commerçants et fabricants en revanche voient leurs moyens de protéger leurs produits anéantis. En effet, l'utilisation de marques est clairement identifiée avec les pratiques corporatistes de l'Ancien Régime. Il était alors possible d'utiliser une marque corporative lorsqu'on faisait partie d'une corporation, ou encore de faire usage d'une marque individuelle. En supprimant les corporations et en posant le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le législateur met fin à ce système avec le décret dit d'Allarde et la loi Le Chapelier [Lois des 2 et 17 mars 1791, 17 juin 1791.]. Les maîtrises et jurandes, manufactures privilégiées, et ainsi les tribunaux qui réglaient auparavant les litiges entre fabricants et ouvriers, disparaissent, laissant certes aux créateurs la possibilité de laisser libre cours à leur inventivité, mais permettant également aux fraudeurs d'agir en toute impunité.
[57] Édouard Clunet, Du défaut de validité de plusieurs traités diplomatiques conclus par la France avec les puissances étrangères, in Journal du droit international privé (Clunet), tome 7, 1880, p. 5-55 : Enfin les traités pour la garantie des marques de commerce rentrent dans la catégorie des traités relatifs à la propriété des Français à l'étranger. C'est pour assurer une propriété que nos diplomates se sont mis en mouvement, qu'ils ont multiplié leurs efforts. Sur ce second point, nous avouons ne pas comprendre la controverse. Soutenir que la marque de commerce, ne constitue pas une propriété, paraîtra une théorie singulièrement hasardée au commerçant, dont c'est souvent le seul patrimoine ; les juristes trouveront en outre que nier un fait aussi certain, aussi sensible pour tous, sur lequel l'accord le plus complet a régné jusqu'ici, et cela dans l'intérêt de quelques traités défectueux ; c'est peut-être téméraire ; qu'en tout cas, c'est une entreprise médiocrement profitable que d'essayer de renverser des théories assises et incontestées pour un intérêt accidentel. La marque de commerce n'est pas une propriété ! Il semble pourtant que le législateur français de 1857 et de 1873 en avait une toute autre idée ; le titre 1er de la loi du 23 juin 1857 est intitulé : “Du droit de propriété des marques.” L'article 2 dit : “Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque”. L'article 17 : “Le propriétaire d'une marque peut faire procéder à la description détaillée, avec ou sans saisie”. L'article 1er de la loi du 26 novembre 1873 : “Tout propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce pourra,” etc. La jurisprudence a suivi dans la voie ouverte par le législateur, et il ne fait doute aujourd'hui pour personne que la marque de commerce ne soit une propriété au sens légal du mot. Nous partageons complètement l'avis de l'un des hommes les plus compétents en cette matière qui s'exprime ainsi : “La question de savoir si un signe distinctif indiquant l'origine du produit peut constituer une propriété n'est plus mise en doute depuis longtemps. Il serait donc aujourd'hui sans objet de rappeler les arguments qui, à diverses époques, ont été donnés pour ou contre ; l'adhésion successive de tous les États du globe et la doctrine dont le Congrès se propose de formuler les bases en vue d'un minimum d'unification internationale enlève tout intérêt à une discussion sur ce point” [M. le comte de Maillard de Marafy, conseil de l'Union des fabricants. Rapport présenté au nom de la section des marques de fabrique et de commerce. Congrès international de la propriété industrielle. 1 vol. in-8, Paris, Imp. nat., 1879, p. 84.]. Au Congrès international de la propriété industrielle tenu à Paris pendant l'Exposition de 1878, et où tous les objets relatifs à la matière ont été discutés par un public d'élite, composé des hommes qui dans tous les pays civilisés se sont occupés des différentes branches de la propriété industrielle, la question n'a même pas été soulevée. Il est enfin un témoignage qu'il n'est pas sans intérêt d'invoquer, c'est le langage même employé par les rédacteurs de l'une des deux conventions, celle avec l'Espagne ; elle est intitulée : “Déclaration pour assurer la garantie réciproque de la propriété des marques de fabrique ou de commerce.” L'article 2 s'exprime ainsi : “Les nationaux de l'un des deux États qui voudront s'assurer dans l'autre État la propriété de leurs marques de fabrique ou de commerce seront tenus de remplir les formalités exigées par les lois et règlements de l'État qui doit accorder la garantie…” Tout s'accorde, la raison et les textes, pour proclamer que la marque de fabrique ou de commerce est une propriété, une propriété de droit commun, semblable aux autres propriétés dans le commerce, que vise et embrasse dans leur ensemble l'article 8 de la Constitution.
[58] Louis Rouanet, Contre les monopoles intellectuels, citant Fritz Machlup, “The Patent Controversy in the Nineteenth Century”, Journal of Economic History, 1950 : Il arriva que ceux qui commencèrent à utiliser le mot propriété à propos des inventions avait un but très précis en tête : ils voulaient substituer un mot à la connotation respectable, “propriété”, à un mot qui sonnait mal, “privilège”. Ce fut un choix clairement délibéré de la part des politiciens travaillant pour l'adoption d'une loi sur les brevets dans l'Assemblée Constituante française.
[59] Ludovic Hennebel, op. cit. : Le rattachement de ce droit au concept de propriété résulte de l'impuissance de la science juridique à ériger un régime sui generis détaché du paradigme traditionnel de la propriété ordinaire.
; Pierre-Emmanuel Moyse, op. cit. : Dans ce feu d'artifice d'idées, il fallait bien accrocher la loi à une cocarde quelconque ! Le mot “propriété” passait pour être tout à fait approprié. Il illustrait suffisamment et le retour au droit naturel romain qui portait l'aura d'un âge d'or révolu et l'idéologie libérale dégagée par la philosophie des Lumières. Sans propriété, point de salut donc. Le législateur révolutionnaire voulut mettre au-dessus de toute discussion les droits nouveaux qu'il venait d'adopter. Pour casser le moule des privilèges il fallut non seulement vivre la nuit du 4 août qui marque symboliquement la fin de l'Ancien Régime, mais encore poser les fondements d'un droit égalitaire et universel. C'est dans ces excès de mots que le droit d'auteur a été acclamé et salué comme un droit de propriété, aussi incontestable que le droit naturel.
[60] Pour ces dernières matières, voir Joseph Lucien-Brun, De la propriété industrielle, Conférence faite à la société d'économie politique de Lyon, sous la présidence de M. Isaac, vice-président de la Chambre de Commerce, par M. Joseph Lucien-Brun, docteur en droit, avocat à la cour d'appel, in Revue catholique des institutions et du droit, 1896/03 (A24,SER2,N3) : C'est à Lyon que revient l'honneur d'avoir obtenu le premier texte de loi relatif aux dessins et modèles de fabrique, honneur que cette ville avait mérité et dont elle est toujours digne par la beauté artistique et la richesse de ses tissus. Il n'est en effet question nulle part de dessins de fabrique avant l'ordonnance de Louis XI du 29 novembre 1466 qui établit à Lyon la première manufacture de draps d'or et de soie, afin d'acclimater en France cette industrie de la soie qui devait bientôt y briller d'un si vif éclat. […] Qu'y a-t-il en effet qui appartienne plus complètement à l'homme que son idée, que le fruit de son travail ; où trouvez-vous un droit de propriété plus exclusif, qui donc pourrait le forcer à en faire part à la société ? Le mot lui-même : découverte, invention n'est-il pas éloquent ; quelle est en effet la base première de la propriété, le mode primitif d'acquérir, sinon la découverte, l'invention de l'objet, ici le code est d'accord avec la raison ; et cette expression de : propriété industrielle, passée dans le langage à la fois scientifique et courant n'en est-elle pas la preuve, car les mots sont l'expression exacte des idées. Que ce ne soit pas la propriété matérielle telle que la comprend le code, je l'accorde parfaitement, mais ce sera une propriété intellectuelle, infiniment plus absolue que la première, on peut en effet nous voler un objet, personne ne vous ravira votre idée tant que vous ne l'aurez pas manifestée ; vous avez donc sur elle un droit bien plus complet, bien plus absolu, bien plus exclusif. […] Les dispositions de la loi [la loi du 28 juillet 1824 sur le nom commercial] sont justes, elles sont nécessaires. Elles sont justes en ce qu'elles donnent une garantie à la propriété industrielle. Je dis propriété ! et en est-il de plus sacrée que le nom d'un fabricant qui, par un travail assidu, une conduite sans tache et des découvertes utiles, s'est placé honorablement parmi les bienfaiteurs de son pays et les créateurs de son industrie ? S'il est glorieux de porter des noms illustres dans la carrière des armes, de la magistrature, de l'administration, il est pareillement honorable de consacrer le sien par de grands services rendus à l'industrie, une des principales sources de la richesse et de la prospérité d'un État.
[rapport du comte Chaptal à la Chambre des Pairs le 17 juillet 1824] […] Au point de vue commercial, le nom devient une enseigne […]. L'industriel a donc sur le nom de sa maison un droit de propriété dans toute la force du terme. En peut-on dire autant des marques de fabrique et de commerce ? Oui, d'après le comte Chaptal, qui assimile la propriété d'une marque à la propriété matérielle et en fait par conséquent une véritable propriété mobilière. Est-ce bien exact ? La propriété d'une marque est-elle nécessaire comme celle des objets matériels, en ce sens qu'elle est le seul moyen possible et imaginable d'utiliser économiquement et pratiquement les objets sur lesquels elle porte ? Évidemment non. La marque ne constitue pas non plus une œuvre originale, une création personnelle de l'esprit comme les œuvres d'art ou les inventions. La propriété d'une marque paraît plutôt une création de la loi, un privilège, un monopole accordé à un industriel dans un but d'utilité publique, qu'une institution de droit naturel. Tous les signes en effet sont à la disposition de chacun pour les employer comme marques, mais du jour où les pouvoirs publics interdisent à tout individu d'employer le signe qui a déjà été adopté par un autre et qui, jusque-là, était à la disposition de tous, ils attribuent ainsi un caractère d'exclusivité à cette marque, la faisant passer du domaine public dans le patrimoine d'un seul. Ce droit individuel de chacun à la marque, droit qui, jusque-là, était naturel, devient, dans la mesure où il est réservé à un seul une création artificielle de la loi. C'est donc une exception très bien fondée, un privilège légitimé par l'intérêt de l'industrie, une faveur que justifie l'utilité publique et que toutes les législations ont consacrée, c'est un droit civil, mais non un droit naturel. Les dessins et modèles de fabrique constituent bien au contraire une propriété dans toute l'acception du mot. Ici en effet nous trouvons l'intelligence qui conçoit et la main qui exécute, et par la réunion de leurs efforts elles créent réellement une œuvre nouvelle, le créateur a donc sur elle un véritable droit de propriété. […] La propriété industrielle en un mot, c'est la liberté du travail dans ses fruits ; la justice veut qu'elle soit protégée.
[61] Lysander Spooner, ''The Law of Intellectual Property – an Essay on the Right of Authors and Inventors to a Perpetual Property in their Ideas, vol. I., Boston, 1855 (je traduis) : Le droit de propriété sur les idées prouvé par analogie. Afin de comprendre la loi de la nature à l'égard de la propriété intellectuelle, il est nécessaire de comprendre les principes de cette loi à l'égard de la propriété en général. Nous devrions voir alors que le droit de propriété sur les idées est au moins aussi fort que le – et dans bien des cas, identique au – droit de propriété sur les choses matérielles. […] Les conclusions, qui découlent des principes maintenant établis, sont à l'évidence qu'un homme a un droit naturel et absolu – et s'il est naturel et absolu, alors un droit perpétuel – de propriété sur les idées qu'il a découvertes ou créées ; que son droit de propriété sur les idées est intrinsèquement le même, et identiquement pour les mêmes motifs, que son droit de propriété sur les choses matérielles ; qu'il n'existe aucune distinction de principe entre les deux cas.
[62] Brian L. Frye, IP as Metaphor, March 28, 2015 (je traduis) : Bien sûr, il existe des théories alternatives de la propriété intellectuelles. En particulier, la théorie du travail avancée par Locke estime que la propriété intellectuelle est justifiée parce que les gens ont un droit naturel à posséder les fruits de leur travail, et la théorie personnaliste de Kant et Hegel affirme que la propriété intellectuelle est justifiée parce que l'autonomie personnelle dépend de la capacité à contrôler les expressions de la personnalité. Bien que les théories du travail et personnaliste puissent décrire avec précision les intuitions populaires sur les justifications de la propriété intellectuelle, elles souffrent de sérieuses faiblesses. Pour commencer, elles sont incompatibles avec la Clause sur la propriété intellectuelle, qui autorise le Congrès “[à] promouvoir le progrès de la science et des arts utiles, en garantissant pour un temps limité aux auteurs et aux inventeurs un droit exclusif sur leurs écrits et découvertes respectifs.” La Cour suprême a constamment établi que la Clause sur la propriété intellectuelle adopte une théorie assistancialiste de la propriété intellectuelle. “La philosophie économique soutenant la Clause donnant au Congrès le pouvoir d'octroyer des brevets et des droits d'auteur est la conviction que l'encouragement de l'effort individuel par le gain personnel est le meilleur moyen d'améliorer le bien-être public à travers les talents des auteurs et des inventeurs dans ‘la science et les arts utiles.’” En outre, ni la théorie du travail ni la théorie personnaliste ne fournissent de base pour déterminer si les droits de propriété intellectuelle sont ou ne sont pas justifiés. La théorie du travail justifie l'octroi de titres de propriété sur des bien rivaux, afin d'empêcher la tragédie des communs, mais ne peut justifier l'octroi de droits de propriété sur des biens non-rivaux. La théorie personnaliste justifie l'octroi de droits de propriété dans les expressions de la personnalité afin de promouvoir l'autonomie, mais ne peut expliquer lorsque ces droits de propriété sont justifiés et lorsqu'ils ne le sont pas. En effet, certains universitaires ont adopté la théorie du travail ou la théorie personnaliste seulement parce qu'ils ont conclu que le système existant de propriété intellectuelle n'est pas justifié par la théorie économique.
[63] Pierre-Emmanuel Moyse, op. cit. : La théorie de la propriété sur la production intellectuelle fut notamment inspirée par les travaux de Locke. Le travail intellectuel, pareillement au travail manuel, fort de son caractère hautement personnel, justifie la place d'un droit de propriété au profit de l'auteur. Les théoriciens de la propriété traditionnelle ne manquèrent pas de reprendre la théorie pour défendre leur cause. Accolas exposa que “toute valeur est la propriété de celui qui l'a produite par son travail intellectuel ou manuel”.
[64] Mami Fujiwara, Diderot et le droit d'auteur avant la lettre : autour de la Lettre sur le commerce de la librairie, Revue d'histoire littéraire de la France 1/2005 (Vol. 105) , p. 79-94 citant Denis Diderot, Lettre historique et politique adressée à un magistrat sur le commerce de la librairie, son état ancien et actuel, ses règlements, ses privilèges, les permissions tacites, les censeurs, les colporteurs, le passage des ponts et autres objets relatifs à la police littéraire : En effet quel est le bien qui puisse appartenir à un homme, si un ouvrage d'esprit, le fruit unique de son éducation, de ses études, de ses veilles, de son temps, de ses recherches, de ses observations ; si les plus belles heures, les plus beaux moments de sa vie ; si ses propres pensées, les sentiments de son cœur ; la portion de lui-même la plus précieuse, celle qui ne périt point ; celle qui l'immortalise ne lui appartient pas. Quelle comparaison entre l'homme, la substance même de l'homme, son âme, & le champ, le pré, l'arbre ou la vigne que la nature offrait dans le commencement également à tous & que le particulier ne s'est approprié que par la culture, le premier moyen légitime de possession. Qui est plus en droit que l'auteur de disposer de sa chose par don ou par vente ? […] Est-ce qu'un ouvrage n'appartient pas à son auteur autant que sa maison ou son champ ? Est-ce qu'il n'en peut aliéner à jamais la propriété ?
[…] Je le répète, l'auteur est maître de son ouvrage, ou personne dans la société n'est maître de son bien. Le libraire le possède comme il était possédé par l'auteur. Il a le droit incontestable d'en tirer tel parti qu'il lui conviendra par des éditions réitérées. Il serait aussi insensé de l'en empêcher que de condamner un agriculteur à laisser son terrain en friche, ou un propriétaire de maison à laisser ses appartements vides.
[Kant, De l'illégitimité de la reproduction des livres (1785), in Qu'est-ce qu'un livre ?, p. 119-132.] […] Par suite, [les ouvrages littéraires] reviennent-ils exclusivement à la personne de l'auteur, et celui-ci y a un droit inaliénable (jus personalissimum). […] Car la propriété qu'un auteur a sur ses pensées (si du moins l'on admet qu'une telle propriété existe selon des droits externes), il la conserve nonobstant la reproduction
.
[65] Mathieu Perona, Aux fondements de la propriété intellectuelle, Notes d'un économiste : [pour Hegel,] si la propriété procède d'une objectivation de la volonté libre d'un individu dans un objet extérieur, alors ce raisonnement s'applique aussi bien, et à plus forte raison, pour les objets dont la nature même est de rendre tangible l'expression d'une idée, la propriété étant liée non au support tangible mais à l'idée elle-même en tant qu'elle procède de la volonté et de l'identité de son auteur.
Derrida ou Foucault ne s'attaquent en fait pas directement à la question de la propriété mais remettent en cause les concepts d'unité du soi et d'originalité. L'auteur est envisagé comme une création sociale en fait distinct de l'individu, et l'individu lui-même constitue un regroupement partiellement arbitraire des différents états d'une personne au cours du temps. S'il n'y a ainsi pas d'individu, les arguments reposant sur l'expression de l'individu tombent, et l'œuvre doit être considérée en elle-même indépendamment de la fiction que constitue son auteur.
[66] Norbert Trenkle, Critique de l'Aufklärung : huit thèses, paru dans Streifzüge n° 56, 2012, traduction de l'allemand : Stéphane Besson.
[67] Pour d'excellents récapitulatifs, voir Gabriel Galvez-Behar, op. cit., l'une des seules études académiques examinant la problématique du rapprochement entre brevets et droits d'auteurs : En fait, ce rapide panorama montre combien la propriété des inventeurs sur leurs inventions et celle des auteurs sur leurs œuvres se posent alors dans des mêmes termes semblables voire identiques. Elles découlent, en fait, d'un principe que Diderot affirmait déjà dans sa Lettre historique et politique sur le commerce de la librairie en 1767.
[…]Le droit du créateur sur ses œuvres est un droit naturel qui constitue la condition de possibilité de toute propriété. Selon cette conception somme toute lockienne, les différentes propriétés intellectuelles découlent donc du même postulat selon lequel nul ne peut être dépossédé de son esprit et des fruits de ce dernier. Inventeurs et auteurs se voient donc rattachés par les lois à la famille des créateurs des œuvres de l'esprit.
[…]Ces progrès de la législation ne doivent cependant pas occulter une contradiction majeure. Alors que les propriétés intellectuelles étaient reconnues comme un droit inaliénable de l'homme, elles se voyaient limitées dans leur durée : les brevets d'invention ne pouvaient être que de quinze ans au maximum tandis que la propriété littéraire ne pouvait survivre que dix ans à l'auteur. Aussi l'une des grandes revendications, tant chez les auteurs que chez les inventeurs, fut-elle de réclamer la perpétuité de la propriété industrielle ou de la propriété littéraire.
[…]C'est Napoléon qui se fit l'interprète d'une telle idée lorsque le Conseil d'État discuta du décret relatif à l'imprimerie et à la librairie (décret du 5 février 1810). Pour Napoléon, la propriété littéraire étant une propriété incorporelle, elle serait divisée au bout de quelques générations par une multitude de personnes qui ne parviendraient alors à se mettre d'accord pour publier les ouvrages dont ils auraient hérité les droits. La propriété littéraire perpétuelle risquait de condamner les meilleurs livres à la disparition.
[…]Ancien élève de l'École normale supérieure, avocat entré au Conseil d'État en 1830, Renouard critique la conception selon laquelle les idées pourraient être l'objet d'une propriété quelconque. Contrairement aux choses, qui, extérieures à la personne, font l'objet d'un effort d'appropriation, les idées font l'objet d'un dessaisissement. Dès lors qu'elles sont émises, elles ne peuvent pas faire l'objet d'une appropriation exclusive par qui que ce soit. La propriété des choses immatérielles est donc illusoire. Un tel renversement ne signifie pas cependant qu'auteurs et inventeurs soient dénués de droits dans l'esprit de Renouard . Si le droit peut leur conférer une “appropriation fictive”, c'est en récompense des services qu'ils rendent en aidant la société à enrichir le vaste fonds des idées. Cette appropriation fictive ne peut donner lieu qu'à une jouissance réservée mais temporaire. La limitation de la propriété intellectuelle dans le temps se fait donc, chez Renouard, au prix d'une négation de cette propriété même.
[…]la loi de 1844 sur les brevets d'invention cessa de caractériser le droit de l'inventeur comme un droit de propriété. Pour son rapporteur à la Chambre des députés, le droit d'exploitation exclusive de l'inventeur n'était plus que la récompense naturelle que la société devait à toute invention utile et non plus l'envers d'un droit de propriété.
[…]Plusieurs observations peuvent être faites à la lumière de ce rapide panorama des remises en cause des propriétés intellectuelles au cours du XIXe siècle. En premier lieu, il convient de souligner que la définition des propriétés intellectuelles n'est jamais définitive. Elle est toujours, au contraire, objet de controverses et de débats. À travers ces débats, se joue la place des inventeurs et des auteurs dans le champ économique : la définition de ces droits reflète, pour une large part, l'importance donnée aux uns et aux autres. Enfin, il existe une double solidarité entre les inventeurs et les artistes. Non seulement les arguments qui fondent leurs droits respectifs découlent de la même source, mais encore ils partagent une position sociale semblables par certains points que reflètent aussi bien certaines œuvres que certaines institutions où viennent se refléter ses enjeux communs.
[…]Au sein de la Société des gens de lettre qu'il rejoint en 1838 et dont il devient président en 1839, Balzac se fit en effet “avocat de la propriété littéraire”, reprenant à son compte l'idée selon laquelle les créations de l'intelligence constituaient une propriété sacrée et dénonçant le caractère temporaire de la propriété littéraire. En somme, alors qu'il mettait en scène, sur le papier les figures romantiques et fraternelles de l'artiste et de l'inventeur, Balzac menait, dans les coulisses de la création, une lutte ardente pour la reconnaissance de ses droits de créateur.
[…]Cette solidarité entre l'inventeur et l'artiste ne se limita cependant pas à l'origine commune de leurs droits ou au caractère gémellaire de leur dimension littéraire. Elle peut être appréhendée également chez bon nombre d'acteurs ou d'institutions destinés à les défendre. Au premier rang de ces acteurs on comptera un certain nombre d'avocats qui firent le lien entre les différentes branches de la propriété intellectuelle et, ce faisant, entre les inventeurs et les artistes.
[…]Adrien Huard, Eugène Pouillet, Association des inventeurs et des artistes industriels, baron Taylor […] Ainsi, au delà de cet air de famille qu'inventeurs et auteurs portent au cœur même de certaines œuvres, l'existence d'acteurs et d'institutions communs souligne la communauté d'intérêt qui existe, au XIXe siècle, pour faire reconnaître la propriété intellectuelle comme une propriété à part entière. À travers ce combat, car les polémiques furent nombreuses, c'est bien la reconnaissance du travail intellectuel qui se joue. Au final, pourtant, les résultats furent différents. Si le droit d'auteur connut un renforcement avec la loi de 1866 qui porta à cinquante ans la durée des droits accordés aux héritiers, les droits de l'inventeur restèrent quant à eux limités à quinze années maximum tout au long du XIXe siècle. Dans quelle mesure, dès lors, un tel contraste ne reflète-t-il pas des différences dans cette communauté proclamée des capacités ? Auteurs et inventeurs furent-ils bel et bien sur le même plan ? Ce sont ces questions qu'il convient maintenant d'aborder.
[…]Assurément, toutes les idées de Montesquieu, celles de Rousseau, celles de Buffon sont passées dans les masses, sont formulées en lois, en mœurs, en axiomes scientifiques. […] On achète maintenant ces œuvres pour la forme, pour la beauté qu'y a mise le génie, pour ce qui est propre à l'âme de Jean-Jacques, à l'âme de Montesquieu, à l'âme de Buffon.
[Balzac]
[…]Ainsi les œuvres artistiques n'ayant aucune utilité, leur privatisation ne gênant personne, contrairement à celle des inventions, leur propriété, fût-elle perpétuelle, ne lèse aucun intérêt. On mesure le caractère paradoxal de l'argument puisque c'est au nom de son absence d'utilité et de fonction sociales que l'auteur, aux yeux de Balzac, devait se voir reconnaître les droits les plus étendus, alors que l'inventeur, enfermé dans la sphère de l'utile, devait se sacrifier aux intérêts de la société.
[…]Ainsi, en 1839, alors qu'une nouvelle loi sur la propriété littéraire était en discussion à la chambre des Pairs, Charles de Montalembert déclarait, en réponse à Gay- Lussac, partisan d'un alignement de la propriété industrielle sur la propriété littéraire : “L'assimilation que M Gay-Lussac a voulu établir entre les inventions de l'industrie et les produits du génie des lettres et des arts est heureusement repoussée par l'instinct et l'expérience du genre humain. L'industrie et le matérialisme qui en résultent ne nous débordent que trop. Réservons quelque suprématie à la pensée […] Quoi qu'on fasse on ne viendra jamais à bout d'élever un brevet d'invention au rang d'un poème épique, le bon sens de tous les siècles repousse toute comparaison entre Papin et Homère S'il en était autrement, l'homme se rapprocherait de la brute il mettrait le corps au niveau de l'âme et c'est là un progrès dont je souhaite ardemment de n'être ni complice ni témoin.” En voulant réserver ”quelque suprématie à la pensée”, Montalembert renvoyait l'auteur et l'inventeur à une échelle de valeur assurant le primat du beau sur l'utile et de l'idée sur la matière.
[…]Les œuvres littéraires ou artistiques ont un caractère d'individualité parfaitement tranché. Par cela même elles constituent une propriété distincte que la loi peut reconnaître. Au contraire ce caractère d'individualité manque aux découvertes réelles ou supposées qui font l'objet des brevets d'invention puisque ce que celui-ci a fait aujourd'hui un autre cent autres pourront le faire demain. C'est pour cela que le monopole conféré par des brevets doit en principe être taxé d'abusif et qu'il peut être complètement aboli par le législateur sans qu'il en résulte rien contre la reconnaissance de la propriété littéraire
[Michel Chevalier (ingénieur et économiste saint-simonien), L'exposition industrielle de 1862, Paris, imprimerie et librairie des chemins de fer, 1862, p. 168]
[…]Dans une telle perspective, l'inventeur perd son titre de créateur puisque son invention n'est pas considérée comme l'expression de sa personne mais comme la découverte d'une chose accessible à d'autres.
[…]Disons en premier lieu que le fonds de référence que constituent les idées de John Locke relayées par Diderot dans la Lettre historique et politique sur le commerce de la librairie fut le ciment des aspirations à la propriété littéraire et industrielle. Force est de constater, toutefois, que la division canonique entre les arts libéraux et les arts mécaniques rendit de plus en plus délicate le recours à cette source commune. Alors que les Lumières avaient ouvert les portes de l'Encyclopédie aux arts et métiers ainsi qu'à l'invention technique, on peut se demander dans quelle mesure le XIXe siècle ne contribua pas à compartimenter toujours un peu plus les différents types de création. Ainsi devrait-on interpréter l'existence d'institutions similaires évoquées plus haut non pas tant comme la preuve de la poursuite d'un but commun mais comme celle d'un cloisonnement toujours plus marqué. Après tout une association générale des artistes et des inventeurs n'aurait-elle pas été possible ? Une autre hypothèse consisterait à dire que ce cloisonnement aurait avant tout bénéficié aux auteurs – même si, bien entendu, il faudrait regarder dans le détail à quels auteurs il profita tout particulièrement – parce que ces derniers représentaient un enjeu économique bien moins important que celui de l'invention technique. De ce fait, les intérêts auxquels ils se heurtèrent furent moins lourds. Alors que le monopole d'exploitation conféré par le brevet pouvait constituer un obstacle de taille pour une partie de l'industrie nationale, le droit d'auteur ne gênait guère que le public ou une certaine partie des éditeurs. Au total, c'est bien ce positionnement relatif de l'auteur et de l'inventeur, de l'œuvre et de l'invention technique que permettent d'explorer ces débats autour de la propriété intellectuelle, et ce, au-delà des mythes construits par les uns et par les autres.
Ou encore Pierre-Emmanuel Moyse, op. cit. : En France comme en Angleterre, et dès l'invention de l'imprimerie (1436) puis du papier (1440), les privilèges permettaient au prince de contrôler par la censure la diffusion des idées et de régler la concurrence entre les membres d'un corps de métier naissant. S'organisant en corporations, bientôt les libraires des deux capitales contrôlèrent le marché, au grand dam des libraires de province. Ceux-ci protestèrent vivement. Ils remirent en cause la reconduction des privilèges qui aurait encore une fois bénéficié au cartel des plus puissants. C'est à cette occasion - que l'on appelle souvent “la bataille des éditeurs” - que l'argument de la propriété légitime de l'auteur sur sa création fut défendu avec ferveur. Parallèlement, le XVIIIe siècle vit apparaître la tendance des gens de lettre, et ce de manière de plus en plus pressante, de réclamer ce qui leur était légitimement dû. Les auteurs ne tardèrent pas à faire leurs les arguments des avocats des éditeurs.
[…]En revanche, dès le milieu du XIXe siècle, le sort du vocable de “propriété” appliqué à la matière fut assez incertain. À cause des questions qu'il engendrait, il disparut des textes législatifs et réglementaires et la Cour de cassation cessa de l'employer en 1887. Il ne réapparaîtra en France qu'avec l'adoption de la loi de 1957. La controverse influença également la rédaction du texte initial de la Convention de Berne.
[…]Renouard fut un fervent adversaire de la théorie du droit de propriété ordinaire si bien qu'il fut même l'un des premiers à employer le vocable de “droit d'auteur”. Selon lui, et en s'appuyant sur les préceptes kantiens, les productions de l'esprit sont des choses insusceptibles d'appropriation. Bien au contraire, la transmission des idées au public est une des conditions essentielles du progrès de l'humanité toute entière. On ne saurait soutenir que le droit d'auteur puisse avoir le caractère de perpétuité, condition et corollaire de la propriété ordinaire. Malgré tout, et c'est là un point très révélateur de la formation des idées de l'époque, il admettait que la vente d'un livre n'avait pas les mêmes effets que celle d'une propriété ordinaire. Bien plus encore, il mettait en garde le lecteur de ne point confondre le livre matériel et le contenu intellectuel du livre. Renouard refusait seulement de voir en une production intellectuelle l'objet d'un droit de propriété. Pour en arriver à cette position, il commença à démontrer que la pensée de l'homme n'est pas susceptible d'appropriation. La pensée est tout simplement propre à chaque homme. On ne peut l'en déposséder. Il en déduisit que l'acceptation légale de propriété, si elle ne pouvait s'appliquer à la pensée elle-même, ne pourrait pas s'appliquer à une portion de celle-ci. En parlant de portion, il désigna les œuvres de l'esprit. Ainsi seule la matière dans laquelle “la forme de la pensée aura été imprimée” pouvait, selon lui, faire l'objet de ce droit. Renouard combattait l'idée de propriété d'une chose, selon lui “inappropriable”, avec d'autant plus de conviction qu'il y voyait l'appauvrissement de l'humanité toute entière. Attribuer à des propriétaires des choses inappropriables lui semblait pure utopie. Les productions de l'intelligence sont comme le feu ou l'eau : elles sont universelles, nul n'est censé en être propriétaire.
[…]Berthaud (1869) et Morillot (1878), notamment, affirmaient que le droit de reproduction ne s'identifie pas avec le droit de propriété du manuscrit. Ils justifièrent cette proposition de façon très intéressante. Puisque les règles du droit de propriété réelle ne permettaient pas d'appréhender le droit de l'auteur sur son œuvre, ils se tournèrent vers une autre catégorie de droit contenue dans le Code napoléonien : les droits personnels. Les idées sont indissociables de la personne qui les produit. Si quelqu'un, d'aventure, cherche à se les approprier, il ne viole pas une propriété, mais un droit personnel. Il y a donc non pas contrefaçon, mais violation des droits de la personne et atteinte à sa liberté. “La contrefaçon, disait Berthauld, n'est pas une atteinte aux biens des auteurs, à leur patrimoine ; elle est une atteinte à leur personne, à leur liberté ; elle n'est pas un vol, elle est une violence”. Le droit d'auteur était ainsi assimilé à un droit de la famille ou de nationalité. En Allemagne, et suite aux travaux de Kant, on vit apparaître de semblables théories. En particulier, Otto Gierke développa la théorie de l'“Urheberpersönlichkeitrecht”. Gierke ne séparait pas nettement les droits de la personnalité des droits patrimoniaux. Ce qui est certain, c'est que les intérêts matériels et les intérêts moraux - composantes essentielles du droit d'auteur - rentraient dans les droits de la personnalité.
[…]Picard résolut de faire du droit d'auteur un droit nouveau, un droit d'invention. Son analyse se référait aux classifications juridiques romaines pour critiquer l'opiniâtreté avec laquelle les jurisconsultes de son époque voulurent faire rentrer le droit d'auteur dans une quelconque catégorie préexistante. Il proposa donc une quatrième catégorie : celle des droits intellectuels.
[…]Picard proposa de traiter les droits selon leur vraie nature, c'est-à-dire séparément des autres droits. Il fallait, selon lui, renoncer à faire entrer, “à coups de marteau”, les droits intellectuels dans les droits réels. C'était là une solution ingénieuse pour mettre fin aux controverses et à toutes les joutes doctrinales. Plus avant dans le développement de sa théorie, Picard écrit : “Aussi s'accoutuma-t-on à dire Propriété artistique, Propriété littéraire, Propriété industrielle, comme on disait propriété d'un immeuble ou d'un meuble matériel. […] Les résultats irrationnels de cette assimilation ne se firent pas attendre. De chose matérielle à chose intellectuelle, les différences de nature et d'origine sont trop grandes pour que le même régime juridique puisse convenir.” En fondant son étude sur les rapports entre le sujet et l'objet du droit, Picard conclut qu'en présence d'objets de natures différentes, le régime de droit alors applicable devait également être différent.
[…]Ainsi, Kohler note que c'est seulement lorsque l'idée est exprimée qu'apparaît l'utilité des droits que nous cherchons à définir. En d'autres termes, une fois créée, l'œuvre devient un bien juridique. La seule finalité des droits sur ces biens immatériels est d'assurer une utilisation économique de la création. Et, tant que l'œuvre n'est pas rendue publique, il n'y a pas lieu de mettre ces droits en vigueur. La création ne doit pas être produite pour le particulier : elle a une fonction sociale importante. La règle juridique, parce qu'elle est garante de cette fonction sociale, prend tout son sens à la publication de l'œuvre. Les droits apparaissent uniquement lorsque l'œuvre rencontre, par l'intermédiaire de l'éditeur, le marché. Les Immateriellegüterrechte tendent donc essentiellement à une utilisation économique de la création. On comprend également l'effet temporaire de ces droits. L'expression d'une idée, une invention ne sont pas susceptibles d'appropriation durable : le but ultime de la création est de renouveler le patrimoine commun de l'humanité, de faire progresser le savoir et la connaissance des civilisations. À la différence de la propriété corporelle, les droits qui permettent l'exploitation de l'œuvre ne portent pas sur l'objet corporel qui enveloppe la création, mais bien sur une forme d'expression particulière, ce qui explique que Kohler emploie l'expression de “droits sur les biens immatériels” pour exposer sa théorie.
[…]Roubier adresse une critique intransigeante envers la théorie de Kohler. Il lui reproche notamment de concevoir le droit sur ces biens immatériels avant tout comme un droit de propriété, quand bien même il emploie l'idiome de “droit sur les biens immatériels”. Pour Roubier, ceci est inacceptable. Si, en matière de propriété ordinaire, le droit se confond avec son objet, cela tient à la nature des choses. Un même raisonnement ne peut être transposé per se aux choses incorporelles. Roubier écrit : “On comprend sans peine que, vis-à-vis d'une chose matérielle, le droit de propriété, qui est le droit le plus plein sur une chose, se confonde avec cette chose ; on ne dit pas : mon droit de propriété sur cette maison, sur ce cheval ; on dit simplement : ma maison, mon cheval. Kohler raisonne comme si on pouvait raisonner de même pour les biens immatériels ; mais c'est un non-sens, parce que les droits patrimoniaux ne se tiennent pas dans les nuages, et que leur contenu est toujours un contenu matériel.” Selon Roubier, l'objet du droit est bien la création ; mais sa véritable nature est celle d'un monopole d'exploitation. Plus précisément, Roubier dira qu'il sert à la conquête de la clientèle, d'où l'invention de l'expression “droit de clientèle”. Ce droit ainsi entendu est alors tendu vers la régularisation du marché à travers la nécessité de créer des monopoles.
[…]L'approche de Roubier est toutefois originale en ce sens qu'il outrepasse l'analyse du rapport de droit objet/sujet, pour en découvrir son utilité, c'est-à-dire sa raison d'être. Il justifie ainsi l'existence d'un droit sur les créations de l'esprit par le seul fait de sa fonction économique. Cela suffit pour justifier la nature particulière de ces droits. La recherche du profit maximum finalise l'élaboration de ces droits. Leur objet est de fixer, d'assurer la clientèle afin que le processus économique puisse se développer d'une façon non anarchique. Les titulaires de tels droits pourront rentabiliser leurs investissements.
[…]Cette analyse, selon nous, est plus pertinente concernant ce que l'on appelle aujourd'hui le droit des marques et le droit des brevets. Elle perd de sa rectitude scientifique lorsque l'on cherche à la transposer dans le domaine du droit d'auteur, notamment parce que ce droit prend en compte des intérêts extra-patrimoniaux.
[68] Gabriel Galvez-Behar, op. cit. : À travers l'analyse de ces dernières apparaît l'unité des partisans de la propriété intellectuelle. L'action de personnages aussi différents que Charles Renouard, le baron Taylor ou Eugène Pouillet, ardents défenseurs du droit des inventeurs et des artistes, suggère qu'au XIXe siècle les différents actes de création pouvaient être perçus d'un même point de vue. En revanche, les différences entre les législations, ainsi que les arguments qui les fondent, permettent d'appréhender la frontière qui s'établit entre l'œuvre et l'invention.
[69] Ainsi que le qualifie le titre d'un article commentant sa biographie : Henri Baudrillart, Un Jurisconsutle économiste – Charles Renouard, Revue des Deux Mondes tome 40, 1880.
[70] Pierre-Joseph Proudhon, Les majorats littéraires : examen d'un projet de loi ayant pour but de créer, au profit des auteurs, inventeurs et artistes, un monopole perpétuel, Paris, E. Dentu, 1863. p. 102 : L'existence d'une propriété foncière ne saurait légitimer en aucune façon la création d'une propriété intellectuelle ; que ni le domaine public, ni la liberté de l'individu, ni le soin de la prospérité publique, ni le droit des producteurs, ne requièrent une semblable garantie ; qu'au contraire toute liberté, toute propriété et tout droit seront en péril, le jour où sera faite, par décret du prince, l'appropriation de l'esprit.
; p. 110 : L'invention reconnue peut donner lieu à un droit de priorité ; elle ne peut servir à motiver une constitution de PROPRIÉTÉ.
; p. 198, 199 : La propriété intellectuelle fait plus que porter atteinte au domaine public ; elle fraude le public de la part qui lui revient dans la production de toute idée et de toute forme. La société est un groupe ; elle existe d'une double et réelle existence, et comme unité collective, et comme pluralité d'individus. Son action est à la fois composite et individuelle ; sa pensée est collective aussi et individualisée. Tout ce qui se produit au sein de la société dérive à la fois de cette double origine. Sans doute le fait de la collectivité n'est pas une raison suffisante pour que nous nous mettions en communisme ; mais réciproquement, le fait de l'individualité n'est pas non plus une raison de méconnaître les droits et les intérêts généraux. C'est dans la répartition et dans l'équilibre des forces collectives et individuelles que consiste la science du gouvernement, la politique et la justice. Or, je vois bien ici la garantie donnée à l'individu ; mais quelle part a-t-on faite à la société ? Que la société doive à l'auteur la rémunération de sa peine, de son initiative, si vous voulez, rien de mieux. Mais la société est entrée en part dans la production ; elle doit participer à la récolte. Cette part à laquelle elle a droit, elle l'obtient par le contrat d'échange, en vertu duquel compensation est faite du service rendu au moyen d'une valeur équivalente. La propriété intellectuelle, au contraire, donne tout à l'auteur, ne laisse rien à la collectivité : la transaction est léonine.
; p. 227 : Il est clair que la forme donnée à la pensée par l'écrivain n'a rien de plus personnel et de plus sacré que la formule du savant ou l'invention de l'industrieux, et que si une redevance perpétuelle peut être accordée à la première, elle ne pourra être refusée aux deux autres.
; p. 240 : Ainsi le principe de la propriété intellectuelle conclut droit, par la servitude de l'esprit, soit à la reconstitution de fiefs, soit au communisme de la terre, déclarée partout propriété de l’État, en un mot à restauration du régime de droit divin ou féodal. Pas une industrie, pas un métier qui, affranchi depuis des siècles ne puisse être monopolisé au moyen de quelques brevets d'invention ou de perfectionnement. Ce qui n'empêche pas les partisans de la propriété intellectuelle d'être en même temps partisans de la libre concurrence et partisans du libre échange, que dis-je ? En voici qui, au moment où ils réclament la propriété littéraire, demandent qu’on supprime le privilège de propriété industrielle par l’abolition des brevets d’invention. Accordez ces contradictions si vous pouvez.
[71] Pierre-André Mangolte, « Brevets d'invention » de Charles Coquelin (1852), une critique de la propriété des inventions : Le préambule de la loi du 7 janvier 1791 affirmait de même que “toute idée nouvelle appartient primitivement à celui qui l'a conçue” et “que ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence, que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur”. Mais en même temps, cette même loi n'accordait à l'inventeur qu'un temps limité de jouissance exclusive, une durée de cinq, de dix ou de quinze ans. […] Il fallut d'ailleurs attendre le vote de la loi de 1844 pour que la contradiction disparaisse ; Philippe Dupin, le rapporteur de la loi à la Chambre des Députés soulignant, après avoir fait référence aux débats de l'année 1841 sur la propriété littéraire, autour de la proposition de Lamartine [Rapporteur d'une loi sur la propriété littéraire en mars 1841, Lamartine avait proposé d'allonger la durée du droit exclusif à 50 ans après la mort, “en attendant de pouvoir dire”, selon sa propre expression, “toujours”.], que le titre de la nouvelle loi ne proclamerait plus “que le droit des inventeurs à une jouissance entière et exclusive pendant un temps limité, en évitant volontairement le terme propriété”. […] Les partisans de la propriété des inventeurs sur leurs inventions, revendiquant haut et fort la perpétuité du droit exclusif, étaient minoritaires et peu nombreux, mais très actifs. Parmi eux, le personnage le plus important dans cette première moitié du siècle est Ambroise-Marcellin Jobard, qui entretient alors une agitation continuelle en faveur de la création de la “propriété intellectuelle”, sur le modèle de la propriété foncière ; cette propriété intellectuelle, qu'il nomme “monautopole”, englobant non seulement les inventions industrielles, artistiques et littéraires, mais aussi les recettes, les secrets, les méthodes, les raisons sociales, les enseignes, les marques, les estampilles, les poinçons,… et jusqu'aux clientèles. Il s'agissait pour lui de lutter ainsi contre l'anarchie économique, contre “cette liberté illimitée de l'industrie et du commerce qu'est la libre concurrence », une liberté « qui n'est qu'une guerre perpétuelle qui conduit à la ruine de l'industrie et du commerce”. Il s'agissait, en créant de la propriété intellectuelle, “d'organiser l'industrie, de discipliner la concurrence, de lutter contre la concurrence étrangère”, de moraliser même l'activité commerciale. En 1852, quand Charles Coquelin écrit son article, l'influence de Jobard est d'ailleurs au plus haut ; mais il meurt en 1861 ; et dans la deuxième moitié du siècle, ce sont deux économistes, pourtant partisans du “laisser-faire” et du libre-échange, Gustave de Molinari (1855) et, un peu plus tard, Charles Hardy de Beaulieu (1868) qui prennent le relai, en arguant de l'existence d'un droit naturel des inventeurs à la propriété de leurs propres productions. […] Il y a donc une différence sensible dans les débats de la première et la deuxième moitié du XIXe siècle. Avant la commission Granville de 1851 et la proposition de Michel Chevalier de 1862, on discute essentiellement de la propriété et de la perpétuité, les opposants prônant un droit limité. Après, on discute plutôt de la « réforme de la loi », c'est-à-dire de l'abolition des brevets d'invention, avec en réaction, la réaffirmation de la thèse de la propriété des inventeurs. L'article de Coquelin se situe juste entre ces deux périodes et ces deux controverses. […] L'auteur va examiner ensuite la thèse de la propriété de l'inventeur, en récusant celle-ci. Il se situe en effet du côté de ceux qui, dans les approches de droit naturel, font de la possibilité d'une possession physique des choses une condition indispensable, avec le travail ou la découverte, pour fonder le droit naturel de l'homme à la propriété, à l'inverse de ceux qui ne retiennent que le travail en récusant toute distinction entre produits physiques et produits intellectuels.
[…] Il n'est pas vrai que l'inventeur soit, dans le sens ordinaire du mot, propriétaire du procédé industriel qu'il découvre ; il n'en est que le premier explorateur. Le droit qu'il acquière n'est pas un droit de propriété, c'est un droit de priorité, rien de plus ; et ce droit a sa limite naturelle dans le droit correspondant qu'ont tous les autres industriels, ses concurrents, de marcher à leur tour dans la voie où il s'est engagé le premier. […] En général, il [l'inventeur] ne fait que rencontrer le premier une vérité qui était sur le point d'éclore, parce que le germe en était déjà dans bien des têtes, et que les besoins de la société, aussi bien que la série des travaux antérieurs, en avaient préparé l'éclosion. […] Il en résulte que les inventions appartiennent à la société pour le moins autant qu'aux inventeurs, et que nul ne peut y prétendre un droit absolu et éternel. […] Vingt, trente, cent individus peuvent en faire usage [de l'invention] à la fois dans autant de lieux différents, sans que l'exploitation de l'un altère en rien l'exploitation de l'autre, sans que le procédé, en se multipliant, perde nulle part son efficacité et sa vertu. C'est là le propre des choses destinées à demeurer communes, et c'est en quoi elles diffèrent essentiellement de celles qui doivent être appropriées. […] Tous ces propriétaires monopoleurs seraient autant de sangsues qui dévoreraient à petit bruit la substance de la nation. […] En réservant à un seul homme l'exploitation d'une invention industrielle, elle [la loi] viole la nature des choses, qui avait voulu que cette invention pût être exploitée par plusieurs ; elle crée un monopole où il n'en existait pas.
[Coquelin].
[72] Susan Sell, op. cit. (je traduis) : La justification des brevets à la fin du dix-neuvième siècle fut un moment clé d'accord. Poser l'analogie des droits de propriété intellectuelle avec les droits de propriété matérielle a rendu la possession de la propriété intellectuelle conceptuellement possible sans aucun problème.
[73] Ludovic Hennebel, op. cit. : Selon [Renouard], les productions de l'esprit ne peuvent être appropriées parce que la transmission des idées à la collectivité est essentielle au progrès de l'humanité. Il propose donc de distinguer l'œuvre matérielle de son contenu intellectuel. Par la suite, Berthaud et Morillot développent les théories dites personnalistes qui rangent les droits d'auteur dans la catégorie des droits personnels car les idées sont indissociables de la personne qui les produit. On ne peut donc pas se les approprier. La contrefaçon est, selon eux, non pas un vol, mais bien une violence exercée à l'égard de la personne de l'auteur.
[74] Louis Rouanet, op. cit. citant Michel Chevalier, Les brevets d'inventions examinés dans leurs rapports avec le principe de la liberté du travail et avec le principe de l'égalité des citoyens, Guillaumin 1878, p.45 : Toute découverte industrielle est le produit de la fermentation générale des idées, le fruit d'un travail interne qui s'est accompli, avec le concours d'un grand nombre de collaborateurs successifs ou simultanés, dans le sein de la société, souvent pendant des siècles. Une découverte industrielle est loin d'offrir au même degré que la plupart des autres productions de l'esprit une empreinte d'individualité qui oblige de la rapporter à qui s'en dit l'auteur, et c'est ce qui rend très équivoque la prétention de celui-ci à la paternité.
[75] Augustin-Charles Renouard, Traité des droits d'auteur, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts, Paris, J. Renouard, 1838-1839, tome 1, p. 253-261, citant Emmanuel Kant, De l'illégitimité de la contrefaçon des livres, 1785 : Celui qui gère l'affaire d'autrui au nom du propriétaire et cependant contre la volonté de celui-ci, est tenu, envers lui ou envers son fondé de pouvoirs, à leur céder et abandonner tout le gain qu'il a retiré de cette affaire, et à les indemniser de toute perte qui peut résulter pour eux de sa gestion. Or le contrefacteur gère précisément l'affaire d'autrui, de l'auteur, au nom du propriétaire et contre sa volonté. Donc il est tenu envers lui, soit envers son fondé de pouvoirs, l'éditeur, à la cession du gain et à l'indemnité de la perte.
[…][1° L'éditeur, contrefacteur ou non, gère l'affaire de l'auteur.] Un livre n'est pas, pour l'auteur, une marchandise, un objet de commerce ; c'est un usage de ses forces (opera) qu'il peut concéder à d'autres, mais qu'il ne peut jamais aliéner. Tout livre est un écrit de l'auteur, par lequel celui-ci parle au lecteur. Celui qui a imprimé cet écrit parle à la vérité aussi au public par les exemplaires ; mais il ne parle point pour soi, il parle au nom de l'auteur, il le présente publiquement comme parlant, il est l'intermédiaire entre l'auteur et le public pour transmettre au public les paroles de l'auteur. Tout exemplaire de ces paroles, manuscrit ou imprimé, est un objet susceptible de propriété privée ; le propriétaire peut s'en servir à son propre usage ; il peut en faire le commerce en son nom. Mais faire parler quelqu'un publiquement, mais porter ses paroles, comme telles, à la connaissance du public, c'est parler au nom de l'auteur, c'est dire au public : “par mon intermédiaire l'auteur vous fait part littéralement de telle ou telle chose ; moi, je ne réponds de rien, pas même de la liberté que prend l'auteur de parler publiquement par mon organe, je ne suis que l'intermédiaire entre lui et vous, chargé de vous transmettre sa parole.” [Note de Renouard : Sans nul doute, l'éditeur, en agissant de telle sorte, ne fait que gérer une affaire d'autrui : on ne pourrait regarder l'affaire comme étant la sienne propre. À la vérité l'éditeur fournit en son propre nom l'instrument muet par lequel s'opère la transmission des paroles de l'auteur au public, instrument qui n'est pas une chose qui est un usage des facultés de l'auteur, opera, c'est-à-dire des paroles littérales, mais il est de toute évidence que c'est au nom de l'auteur que l'éditeur porte, par la voie de l'impression, ces paroles à la connaissance du public ; ce n'est qu'au nom de l'auteur qu'il se présente comme étant celui par lequel l'auteur parle au public.] 2° Le contrefacteur gère l'affaire contre la volonté de l'auteur. En effet, il n'est contrefacteur que parce qu'il empiète sur les pouvoirs de celui que l'auteur a chargé d'être l'éditeur de son écrit : et il s'agit de savoir si l'auteur a le droit d'accorder à un tiers les mêmes pouvoirs qu'il a déjà conférés à un éditeur, ou de consentir à ce qu'un tiers exerce ces mêmes droits. Or il est évident que, comme chacun de ces deux individus, savoir : l'éditeur primitif et le contrefacteur qui s'arroge le droit d'être l'éditeur, gérerait l'affaire de l'auteur avec le même public, la gestion de l'un rendrait inutile celle de l'autre et lui serait préjudiciable. Ainsi on doit regarder comme impossible que l'auteur soit admis à ajouter à la convention avec l'éditeur une clause par laquelle il se réserverait la faculté d'accorder encore à d'autres la permission d'être éditeur du même écrit. D'où il suit ultérieurement que l'auteur n'a pu donner cette permission à un tiers, au contrefacteur, et que ce dernier n'a même pu présumer le consentement de l'auteur. De tout quoi il résulte que la contrefaçon est la gestion d'une affaire d'autrui, faite au nom du propriétaire, mais contrairement à sa volonté légale. Il suit également de cet argument que ce n'est pas l'auteur, mais son éditeur-mandataire, qui se trouve lésé par la contrefaçon ; car, l'auteur ayant abandonné à l'éditeur la gestion de son affaire avec le public, entièrement et sans réserve d'en disposer ultérieurement, l'éditeur est seul propriétaire de cette gestion, et le contrefacteur préjudicie aux droits de l'éditeur, non à ceux de l'auteur. Toutefois, comme ce droit de gestion des affaires de l'auteur peut également être exercé par un tiers qui y mettrait l'exactitude nécessaire, et qu'il n'est pas inaliénable par la nature des choses, jus personalissimum, mais seulement en tant que telle serait la convention des parties, l'éditeur est autorisé à céder son droit à un tiers, parce qu'il est propriétaire de la procuration. L'auteur ne peut refuser son consentement à cette cession, et le cessionnaire ne saurait être qualifie de contrefacteur : il est un éditeur muni d'un pouvoir légal, comme étant entré aux droits de l'éditeur primitif constitué par l'auteur.
[…]La propriété d'une chose ne peut jamais, par elle seule, emporter un droit personnel affirmatif sur un tiers. Le droit d'être l'éditeur d'un écrit est un droit personnel affirmatif. Donc ce droit ne saurait résulter de la seule propriété de l'exemplaire, qui est la propriété d'une chose. Une conséquence nécessaire de la propriété d'une chose, c'est le droit négatif du propriétaire de s'opposer à toutes entreprises de tiers qui tendent à lui faire obstacle dans l'usage illimité de cette chose ; mais la simple propriété d'une chose ne saurait emporter un droit affirmatif sur la personne, savoir : le droit d'exiger d'elle quelques prestations ou services. À la vérité, ce droit pourrait être établi par une clause particulière du contrat d'acquisition de la propriété ; et c'est ainsi qu'on peut stipuler, lors de l'achat d'une marchandise, que le vendeur devra l'envoyer, franche de port, à tel endroit. Mais alors le droit sur la personne, ou son obligation de faire, ne résulte pas de la simple propriété de l'objet vendu, elle est l'effet de la clause additionnelle. J'ai un droit dans la chose, lorsque je puis disposer de cette chose à volonté et en mon propre nom. Si la faculté de disposer ne m'appartient qu'au nom d'autrui, je gère les affaires de cet autre ; et celui-ci se trouvé obligé par ma gestion de la même manière que s'il avait administré lui-même ses affaires : quod quis fecit per alium, id ipse fecisse putandus est. Il s'ensuit que mon droit de gérer une affaire au nom d'autrui est un droit personnel affirmatif, en ce que je puis forcer le propriétaire de l'affaire à quelque prestation, savoir : à l'accomplissement des engagements que j'ai contractés en son nom. L'éditeur parle au public, par la voie de l'impression, au nom de l'auteur ; il gère donc les affaires d'autrui. D'où il suit que le droit de faire cette gestion est un droit sur la personne ; il consiste, non seulement dans la faculté de se défendre contre les entreprises que ferait l'auteur contre l'usage illimité de la propriété, mais encore dans la faculté de forcer l'auteur à reconnaître comme ses propres actes tous ceux que l'éditeur a faits au nom de l'auteur dans l'affaire dont il s'agit, et d'en répondre : ce qui est un droit personnel affirmatif. […] L'auteur et le propriétaire de chaque exemplaire ont, l'un et l'autre, le droit de dire : c'est mon livre. Mais cette expression a un sens différent dans chacun des deux cas. L'auteur regarde son livre comme écrit, comme des paroles ; le propriétaire considère son exemplaire comme l'instrument muet qui lui communique les paroles adressées par l'auteur au public. Le droit de l'auteur n'est pas un droit dans la chose, dans l'exemplaire ; car le propriétaire pourrait brûler l'exemplaire aux yeux de l'auteur ; c'est un droit inné, personnel ; c'est le droit d'empêcher qu'un tiers le fasse parler au public sans son consentement. Celui qui se fait éditeur sans une convention préalable avec l'auteur, ou, dans le cas où celui-ci a déjà accordé ce droit à un premier éditeur, sans convention avec ce dernier, est un contrefacteur ; il lèse les droits du véritable éditeur, auquel il doit, par conséquent, des dommages et intérêts.
[…]J'ai dit que l'éditeur ne gère point l'affaire en son propre nom, mais au nom d'autrui, de l'auteur, et qu'il ne la peut faire gérer sans le consentement de ce dernier. Cette proposition se confirme par l'existence de certaines obligations qui, selon l'opinion commune, sont à la charge de l'éditeur. Si l'auteur meurt après avoir remis son manuscrit à l'éditeur, et après que celui-ci s'est engagé à le faire imprimer, l'éditeur ne peut, en le regardant comme sa propriété, l'anéantir. À défaut d'héritiers de l'auteur, le public a le droit de forcer l'éditeur à publier l'ouvrage, ou à céder le manuscrit à un autre libraire qui s'offre d'en être l'éditeur. En effet, il s'agit d'une affaire que l'auteur voulait faire avec le public et dans laquelle l'éditeur avait consenti à servir d'intermédiaire. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu, d'avance, de la part du public, connaissance et acceptation de la promesse de l'auteur : le public peut exiger l'accomplissement des obligations de l'éditeur en vertu de la loi seule. L'éditeur n'a obtenu la possession du manuscrit que sous la condition d'en faire usage pour une affaire qui se traite entre l'auteur et le public : son engagement envers le public subsiste, quoique celui qui a existé vis-à-vis de l'auteur se soit éteint par la mort de ce dernier. On voit que je n'invoque point un prétendu droit du public sur le manuscrit. Mon argument repose sur l'existence d'une affaire entre l'auteur et le public. Si, après la mort de l'auteur, l'éditeur publiait l'écrit tronqué ou falsifié, ou s'il n'en faisait pas tirer un nombre suffisant d'exemplaires, le public aurait le droit d'exiger une scrupuleuse fidélité, et une augmentation du nombre des exemplaires : faute par l'éditeur d'y obtempérer, le public pourrait accorder à un autre libraire le droit d'être éditeur de l'écrit. Tout cela ne pourrait avoir lieu, si le droit de l'éditeur ne résultait pas d'une affaire entre l'auteur et le public, affaire que l'éditeur gère au nom du premier. Ces obligations de l'éditeur une fois admises, on doit aussi admettre à son profit un droit corrélatif, sans lequel il se trouverait hors d'état de remplir ces obligations. Ce droit consiste en ce que la faculté de publier l'écrit doit être interdite à tout autre individu, parce qu'une concurrence dans ces sortes d'affaires mettrait l'éditeur dans l'impossibilité de les gérer.
[76] Kant cité par Augustin-Charles Renouard, op. cit. : Il y a, en ceci, une grande différence entre les écrits et les objets d'arts. Celui qui a acquis un exemplaire de ces derniers, peut les imiter ou les mouler, ou en vendre publiquement des copies, sans qu'il ait besoin du consentement de l'auteur de l'original ou des individus dont celui-ci s'est servi pour donner une forme matérielle à ses idées. Un dessin que l'auteur a fait graver sur cuivre ou qu'il a fait exécuter en pierre, en métal, en plâtre, peut être réimprimé ou moulé par l'acheteur, et celui-ci pourra vendre publiquement les nouveaux exemplaires ainsi produits : en général tout ce que je puis faire de ma chose en mon propre nom, est permis par soi-même, sans que j'aie besoin du consentement d'autrui. La Collection d'empreintes de pierres antiques de M. Lippert pourrait être imitée par chaque possesseur qui s'y entendrait, sans que l'inventeur pût se plaindre de la mise en vente de ces imitations ; car cette collection est un ouvrage (opus et non pas opera alterius) ; chaque possesseur peut le vendre sans indiquer et engager le nom de l'auteur ; il peut donc également l'imiter et faire commerce des imitations qui sont son propre ouvrage. Le motif, donc, pour lequel tous les ouvrages d'art peuvent être imités, et leurs imitations vendues publiquement, tandis que la contrefaçon des livres publiés par un éditeur légalement constitué est illicite, c'est que les premiers sont des ouvrages (opera) et les seconds, des actions ou des faits (operæ) ; ceux-là ont leur existence par eux-mêmes, tandis que ceux-ci n'ont d'existence que comme émanation d'une personne. Ainsi le livre, qu'il faut distinguer de ses exemplaires, appartient toujours exclusivement à la personne de l'auteur qui jouit à cet égard du droit inaliénable, jus personalissimum, de parler toujours lui-même par l'organe d'autrui ; c'est-à-dire que personne n'est autorisé à communiquer au public les paroles de l'auteur autrement qu'au nom de ce dernier. Toutefois un changement de l'écrit, en l'abrégeant, l'augmentant ou le refondant, tel qu'on aurait tort de l'attribuer dorénavant à l'auteur primitif, ne saurait être réputé contrefaçon : ce serait une refonte faite au propre nom de l'éditeur. En effet, un autre auteur fait alors gérer par son éditeur une affaire différente de celle de l'auteur primitif ; le second éditeur n'empiète pas sur l'affaire qui existe entre le premier et le public ; il ne présente pas au public le premier auteur comme parlant par son organe, mais il en présente un autre. De même, la traduction de l'écrit dans une autre langue n'est pas une contrefaçon ; car la traduction ne contient pas littéralement les paroles de l'auteur, bien que les idées puissent être les mêmes.
[77] Pierre-Emmanuel Moyse, op. cit. : En d'autres termes, pour le droit romain, la chose matérielle, soumise totalement au droit réclamé, représente le droit. Par extension, on dit ma maison, mon stylo… A contrario, il ne peut y avoir de droit sur une chose incorporelle puisqu'elle ne permet pas d'en donner une représentation concrète. L'empreinte de la possession matérielle empêche toute construction juridique nécessaire à la justification des règles du droit d'auteur. Le niveau d'abstraction n'est pas encore suffisant. En témoignent ces réflexions de Gaius, qui, dans un des rares passages de son œuvre, s'attarde à fixer les règles de la possession mobilière lorsque le meuble est une œuvre : “Pour la même raison, il faut approuver la solution suivante : si on trace, fût-ce en lettres dorées, des caractères sur un rouleau de papyrus ou une feuille de parchemin t'appartenant, ils t'appartiennent également, car les caractères suivent le rouleau ou la feuille. […] Mais si sur une planche t'appartenant, on peint par exemple un tableau, il faut adopter la solution inverse : il faut mieux dire, en effet, que le panneau suit la peinture…”
[78] Lucien Bastide (Substitut du Procureur de la République), L'union de Berne de 1886 et la protection internationale des droits des auteurs et des artistes, Paris, A. Giard, 1890 : Si l'on écarte le droit que possède l'écrivain, le peintre, le sculpteur sur l'objet matériel produit par son travail, le manuscrit, le tableau, la statue, droit qui n'est autre que celui de propriété ordinaire et qui n'a rien de commun avec le droit d'auteur, on voit que ce dernier a pour objet la forme immatérielle, intellectuelle de l'œuvre, et que son exercice consiste essentiellement, pour le créateur de cette œuvre, dans la faculté de la reproduire à l'exclusion de tous autres. Peut-on légitimement voir un droit de propriété véritable dans cette prérogative ? Ce qui peut faire hésiter, c'est qu'on est accoutumé de voir le droit de propriété se présenter sous une forme pour ainsi dire corporelle, et s'appliquer à un objet tangible, alors que, au contraire, le droit dont nous nous occupons actuellement, échappe par sa nature et par son objet à cette double matérialisation.
[79] Bertrand Lemennicier, Brevets d'invention, droits de reproduction et propriété intellectuelle : Les idées présentent les caractéristiques suivantes. Elles sont en quantités limitées, elles peuvent être découvertes à la fois en cent lieux différents et elles sont fugitives. Celles-ci, une fois divulguées, nourrissent l'esprit de quelqu'un. Rien ne peut être entrepris pour les restituer puisqu'elles sont incorporées dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Les notions de possession, de contrôle, d'appropriation, de restitution, d'occupation qui définissent si bien la propriété d'une chose sont semble-t-il largement inapplicables aux produits intellectuels. Pour une grande fraction de ceux qui les produisent et les communiquent, elles sont aussi l'expression de la personnalité de leur créateur. Ce qui a donné lieu à une revendication de l'artiste pour avoir un droit moral sur son œuvre. Enfin, nous dit-on une idée peut appartenir à un nombre illimité de personnes ; c'est l'essence même d'une idée que, une fois publiée, elle appartienne à tout le monde. C'est sur cette argumentation que beaucoup de gens considèrent que les idées ne peuvent faire l'objet d'un droit de propriété. […] La question fondamentale n'est donc pas la création d'une œuvre de l'esprit ou d'une invention technique mais sa reproduction et sa dissémination afin d'en tirer un revenu. Or reproduire et disséminer, par définition, est un rôle rempli par l'industriel ou l'éditeur sachant que l'inventeur et l'auteur peuvent tout à fait se transformer en industriel ou éditeur. […] L'auteur (respectivement l'inventeur) peut devenir éditeur (respectivement industriel) et reproduire ses œuvres en grandes quantités, il peut les distribuer en créant sa propre librairie (ou son propre réseau de distribution). Il ne le fait pas parce que cela lui coûte ou parce qu'il se sent incapable de le faire lui-même. Il est clair cependant que cela dépend de la technologie. Ainsi l'apparition d'Internet permet aux auteurs de diffuser leurs œuvres sans passer par la reproduction. Il n'a pas besoin de faire des copies. Il met son manuscrit en ligne et n'importe qui peut y accéder.
[80] Laurent Pfister, Mort et transfiguration du droit d'auteur ? Éclairages historiques sur les mutations du droit d'auteur à l'heure du numérique, Bulletin des bibliothèques de France, n° 5, 2006 : Le recul historique permet aussi de mettre en évidence la concurrence récurrente entre deux modèles du droit d'auteur – la propriété privée et le contrat social –, dont les deux tendances antagonistes actuelles ne sont que des avatars et dont l'une d'elles sera, peut-être, le paradigme de demain. […] Le modèle du contrat social atteint au XIXe siècle sa maturité. Il est systématisé et défendu avec vigueur contre une prolongation excessive des droits patrimoniaux, par un courant de pensée emmené par l'éminent juriste Renouard et rejoint par l'anarchiste socialiste Proudhon. Il inspire encore en partie la réforme du droit d'auteur envisagée en 1936 par le Front populaire, présentée par Jean Zay et finalement abandonnée.
[81] André Weiss, Traité théorique et pratique de droit international privé, Paris, L. Larose & L. Tenin, 1892, tome 2 : Section III. – Droits patrimoniaux intellectuels. Le droit que les législations modernes attribuent au littérateur, à l'artiste, à l'inventeur, au fabricant, sur les produits de leur intelligence ou de leur industrie, n'est ni un droit personnel ni un droit réel. […] De sa nature, le droit de propriété est exclusif ; il est absolu ; il est perpétuel. Il est exclusif, en ce qu'il met obstacle à l'exercice de tout droit rival et parallèle sur son objet ; il est absolu en ce que le propriétaire est maître de sa chose, au point d'avoir la faculté de la détruire ; enfin il est perpétuel, c'est-à-dire qu'il s'exerce et se transmet à l'infini, sans limitation de durée. Or ces caractères essentiels du droit de propriété ne se retrouvent pas dans ce qu'on est convenu d'appeler la propriété intellectuelle. […] En effet, si les droits intellectuels ne doivent pas être confondus théoriquement avec la propriété véritable, dont ils diffèrent par leur nature et par leur objet, ils n'en constituent pas moins une portion souvent notable du patrimoine. […] Et en effet, si l'origine première de la richesse est le travail, aucune prérogative ne peut se réclamer avec plus de fierté du droit naturel que celles que le littérateur et l'artiste exercent sur les conceptions de leur intelligence et de leur art. Dès que l'homme est, il pense ; et sa pensée lui appartient. Maître de la garder pour lui, il l'est aussi de la divulguer, de la répandre par la plume ou par le pinceau, d'en retirer tout le profit qu'elle peut donner, sous les formes diverses qu'elle est susceptible de revêtir.
[82] Projet de loi sur la propriété artistique, présenté, au nom de M. Jules Grévy, Président de la République française, par M. Jules Ferry, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Journal officiel de la République française, Lois et décrets, Onzième année, n° 352, mercredi 24 décembre 1879, p. 11512, Séance du 24 juillet 1879 : La création d'une œuvre d'art confère à son auteur deux droits qu'il faut se garder de confondre : l'un porte sur l'objet matériel, le corps certain qui sera, par exemple, un tableau ou une statue : l'autre consiste dans la reproduction de l'œuvre d'art par un procédé quelconque. Le premier de ces droits est un droit de propriété ordinaire et doit être régi par la loi commune. Le second, que l'on désigne sous le nom de “propriété artistique”, est bien une propriété véritable. La propriété artistique a la même origine que la propriété de l'objet matériel ; toutes deux découlent du travail de l'artiste. Elles sont donc également respectables. Toutefois la propriété artistique est d'une nature particulière et, pour ce motif, elle doit être soumise à une réglementation spéciale. Tels sont les principes sur lesquels repose le projet actuel.
Si la propriété artistique est une propriété, elle constitue du moins une propriété sui generis.
; a contario Édouard Clunet, op.cit. : La propriété littéraire et artistique est une des formes de la propriété pour laquelle en ces derniers temps le législateur a montré le plus de sollicitude, et en faveur de laquelle l'action diplomatique s'est le plus activement employée, encore que son œuvre soit loin d'être terminée. Le mot propriété revient invariablement sous la plume des diplomates. On aurait du reste mauvaise grâce à contester que la propriété littéraire ou artistique soit une propriété, aujourd'hui que dans des assises imposantes, tenues, à fréquentes reprises au cours de ces dernières années, les principes suivants ont été votés avec acclamation : “Le droit de l'auteur sur son œuvre constitue non une concession de la loi, mais une des formes de la propriété que le législateur doit garantir” [Congrès littéraire international de Paris en 1878, article 1.]. — “Le droit de l'artiste sur son œuvre est un droit de propriété ; la loi civile ne le crée pas ; elle ne fait que le réglementer” [Congrès international de la propriété artistique, Paris, 1878.]. Le gouvernement, s'inspirant à son tour des doctrines consacrées dans ces occasions solennelles, vient de déposer un projet de loi sur la propriété artistique où il proclame l'assimilation de la propriété artistique à la propriété ordinaire.
[83] Grus C. Ricordi and Durdilly et comp. , Cour de Cassation, 25 juillet 1887 : Les droits d'auteur et le monopole qu'ils confèrent, désignés d'ordinaire sous la dénomination de propriété littéraire, ne constituent pas, à proprement parler, une propriété, ils confèrent seulement aux personnes qui en sont investies le privilège exclusif d'une exploitation commerciale temporaire. En conséquence, les conventions internationales relatives à la protection littéraire n'ont, en réalité, pour objectif que l'exploitation commerciales des œuvres d'esprit et d'art. Elles entrent ainsi dans les termes “traités de commerce” et sont, dès lors, valablement conclues par le pouvoir exécutif, quand la Constitution l'autorise à “faire des traités de commerce”.
; France, Propriété littéraire et artistique, œuvres musicales, décret du 28 mars 1852, caractère légal et constitutionnel du traité franco-italien du 29 juin 1862, loi italienne, Le droit d'auteur, organe officiel du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, Première année, N° 12, 15 Décembre 1888, Cour de cassation, ch. des requêtes, 25 juillet 1887, Prés. M. Bédarrides ; Cons. rapp. M. Lepelletier, av. gén. M. Chévrier (concl. conf.), Gros c. Ricordi et Cie, et Durdilly et Cie, Av. pt. M-P. Robiquet : Loin de constituer une propriété comme celle que le code civil a définie et organisée pour les biens meubles et immeubles, les droits d'auteur et le monopole qu'ils confèrent donnent seulement à ceux qui en sont investis le privilège exclusif d'une exploitation temporaire. […] Mais, pas plus que les précédents, le décret de 1852 n'assimilait la propriété des œuvres artistiques ou littéraires à la propriété ordinaire. Le prince Louis-Napoléon avait bien, dans la lettre tant citée, écrite par lui du fort de Ham, exprimé cette pensée “que l'œuvre intellectuelle est une propriété comme une terre, comme une maison, qu'elle doit jouir des mêmes droits et ne pouvoir être aliénée que pour cause d'utilité publique” […] La législation postérieure au décret lui-même, les lois de 1854 et de 1866 qui ont été édictées, non pour restreindre, mais pour étendre au profit des auteurs ou de leurs représentants les droits résultant de la législation antérieure, n'ont pas changé la nature de ces droits et n'en ont pas fait une propriété de droit commun. Dégageons-nous donc de cette idée fausse que la propriété d'une œuvre artistique ou littéraire serait une propriété ordinaire, comme celle que le code civil a organisée pour les biens, meubles ou immeubles ; ne nous laissons pas abuser par les mots, et comprenons bien que si la loi de 1866 et les textes qui l'ont précédée ont pour titre “Propriété littéraire, Droits de propriété”, leurs dispositions n'eurent en réalité pour but que d'assurer et en même temps que de limiter les droits qui ont pour objet les œuvres de l'esprit. Si les textes eux-mêmes ne le démontraient pas, on en trouverait la preuve dans la discussion à laquelle a donné lieu la loi de 1866. Dans l'exposé des motifs, M. le conseiller d'État Riché prenait soin d'expliquer lui-même que le droit qu'il s'agissait alors de réglementer n'était pas une propriété. “Le droit, disait-il, qu'on appelle en Allemagne et en Angleterre droit de copie, d'édition, de multiplication, a reçu en France le nom de propriété littéraire. Des écrits de quelques auteurs du dix-huitième siècle tels que Linguet, cette expression, en harmonie avec le goût de notre langue moderne pour les mots ambitieux et abstraits, a pénétré dans le style officiel, et les lois ont prononcé ce mot, mais toujours en face d'un droit temporaire. Mais les mots en France ont leur influence… et le mot de ‘propriété littéraire' a depuis quelques années obscurci la notion exacte du droit très respectable, mais artificiel et limité, que le législateur moderne a inventé. Dégageant la chose de la fausse logique du mot, interrogeant la nature et l'histoire de ce droit sui generis, la majorité des auteurs, des jurisconsultes et des économistes n'y a vu qu'une concession de la loi, concession juste, mais volontaire, devant concilier, par la restriction même de la durée, la récompense due à l'auteur avec l'intérêt du public.”
[84] Ludovic Hennebel, op. cit. : Depuis la révolution française, les législateurs ont sculpté le modèle du droit d'auteur par référence à la logique du marché. Le rattachement de ce droit au régime de la propriété privée le démontre. […] Aujourd'hui, le droit d'auteur, au même titre que le copyright, répond à la seule logique du marché. La référence au concept de propriété, quelle qu'en soit la justification, semble donc légitimer la “marchandisation” des œuvres de l'esprit.
[85] Susan Sell, op. cit. (je traduis) : Dans les années 1980, les États-Unis ont embrassé la conception que la protection de la propriété intellectuelle était primordialement un système pour la protection et l'exclusion plutôt qu'une politique publique pour promouvoir la compétition et la diffusion. La structure du capitalisme global a évolué pour produire de nouvelles pressions sur le cadre intérieur de la protection de la propriété intellectuelle.
[86] Alfred Nion, Droits civils des auteurs, artistes et inventeurs, Paris, Joubert, 1846. La propriété a pour base, pour principe unique, l'intelligence et l'activité de l'homme, le travail en un mot. […] Il y a, dit-on, beaucoup de travaux intellectuels qui sont rémunérés et qui cependant n'enfantent rien qui soit susceptible de propriété. Le médecin qui se présente à votre chevet et vous donne des soins, l'avocat qui défend vos intérêts devant la justice, le professeur qui instruit vos enfants, l'administrateur, le ministre, le magistrat, tous ces hommes font un travail qui exige de grandes facultés intellectuelles, et cependant ils trouvent leurs moyens d'existence dans l'échange qu'ils font des résultats de leurs travaux avec d'autres objets matériels, sans qu'on ait jamais songé à leur accorder un droit de propriété. Mais sur quoi ce droit pourrait-il porter ? est-ce sur la santé que le médecin a rendue au malade ? est-ce sur les connaissances que le professeur a fait, par ses leçons, acquérir à l'élève ? Il est évident qu'il n'y a là aucune analogie à établir avec l'œuvre produite par l'artiste, l'homme de lettres ou l'inventeur ; les premiers ne créent rien, tandis que ces derniers donnent naissance à une statue, à un livre, à une machine. […] Pour les choses matérielles et pour les créations intellectuelles, la source de ce droit est unique, identique ; c'est le travail de l'homme qui crée ou qui identifie l'objet extérieur, corps matériel ou pensée du domaine public, avec sa propre individualité. […] comme la loi positive a changé la nature de cette branche de la propriété intellectuelle et en a fait un objet matériel, un brevet, l'application des dispositions du droit commun ne peut, en ce qui la concerne, donner lieu au moindre doute. […] Le droit des inventeurs industriels a sa cause et son origine dans le travail de la pensée. Cette vérité est incontestable cependant ce n’est qu'en 89 qu'on a reconnu pour la première fois que l'homme doit avoir la propriété de ses idées, de ses découvertes industrielles comme de ses conceptions littéraires et artistiques. […] Cependant est-il besoin de dire que le brevet n'est pas la source du droit de propriété industrielle, qu'il est non pas une concession, une libéralité faite à l'inventeur par le gouvernement, mais uniquement une prise de date vis-à-vis de ceux qui plus tard pourraient prétendre aussi à la découverte ? […] Ainsi, théoriquement parlant le droit de l'inventeur comme celui de l'artiste ou du littérateur est incorporel, c'est le droit exclusif de publier l'œuvre de sa pensée ; mais la loi, qui a laissé au droit des artistes et des littérateurs sa nature immatérielle, a cru devoir, dans l'intérêt du commerce et de l'industrie, convertir ce droit des inventeurs en un objet corporel, en une patente, un brevet. D'après la loi positive, le droit de l'inventeur n'est que la faculté de réclamer ce brevet ; néanmoins nous avons voulu, pour l'honneur des principes, constater tout d'abord que l'inventeur, comme le littérateur, et l'artiste tient de lui-même, de son génie, et non de la libéralité du gouvernement, le droit qu'il a sur les produits de son intelligence. […] Après avoir écrit en tête de notre travail la maxime de justice éternelle qui domine et éclaire toute la science du droit, comme domine et éclaire la science de la philosophie le principe que les sages de l'ancienne Grèce avaient gravé sur le fronton du temple de Delphes, nous avons reconnu que les droits de l'homme sur les œuvres de sa pensée étaient des droits de propriété. Nous aurions pu nous borner à écrire cette vérité, car elle contient tous les systèmes, toutes les théories, toutes les solutions de détail que nous avons cru devoir dérouler ensuite. […] En effet, les droits accordés à l'homme sur les produits de son intelligence, sont de deux natures toutes différentes. Le droit sur les découvertes et inventions industrielles prend une forme saisissable et se matérialise dans un brevet. […] Mais le droit des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques ne se résume pas comme celui des inventeurs dans un parchemin, il reste incorporel.
[87] Mark A. Lemley, Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Property, February 2, 2011, University Chicago Law Review, Vol. 71, p. 129, 2004, UC Berkeley Public Law Research Paper No. 144 (je traduis) : Les justifications a posterirori semble apporter un soutien économique aux légions de nouveaux détenteurs de propriété intellectuelle qui revendiquent un droit à s'emparer de toute valeur possible issu de “leur” information – une optique que les universitaires ont raillée comme étant “s'il y a de la valeur, alors il y a un droit.”
[88] Peter Drahos, The Universality of Intellectual Property Rights: Origins and Development, in Intellectual Property and Human Rights, World Intellectual Property Organization, Geneva, 1999 (je traduis) : Une définition de la propriété intellectuelle qui aille au-delà des listes ou des exemples et qui tente de s'occuper des attributs essentiels de la propriété intellectuelle doit se concentrer sur deux éléments : l'élément de propriété et l'objet auquel se rapporte l'élément de propriété. Les droits de propriété intellectuelle sont souvent décrits comme des droits intangibles. L'idée derrière cette classification est que l'objet du droit est intangible. Tous les droits de propriété placent le détenteur du droit dans une relation juridique avec autrui. La différence clé entre les droits de propriété réelle et les droits de propriété intellectuelle est que dans le dernier cas, l'objet du droit n'est pas physique. On peut y penser comme à un objet abstrait plutôt qu'un objet physique. Il est possible qu'on puisse “posséder” l'objet abstrait sans posséder une manifestation physique particulière de cet objet abstrait. Une lettre envoyée à un ami, par exemple, a comme résultat la propriété de la lettre passée à cet ami, mais pas du droit d'auteur. Pour l'objectif de cet article, nous diront que les droits de propriété intellectuelle sont des droits d'exploitation de l'information.
[89] Sam Williams, Richard Stallman & Christophe Masutti, Richard Stallman et la révolution du logiciel libre. Une biographie autorisée, Eyrolles, 2010 : Je ne parlerais pas aujourd'hui de “possession du savoir” car c'est une idée beaucoup trop large. Cependant, généraliser en parlant de “possession du savoir” n'est pas la même chose que généraliser en parlant de “propriété intellectuelle”. Ce dernier terme englobe trois législations qu'il est crucial de différencier pour comprendre toute question juridique concernant la “possession du savoir”. Les brevets accordent une exclusivité directe sur l'utilisation de savoirs spécifiques ; c'est bien une forme de “possession du savoir”. Le copyright est l'une des méthodes utilisées pour empêcher le partage d'œuvres qui peuvent recéler ou enseigner des savoirs, ce qui est tout à fait différent. Les marques déposées, elles, concernent d'autres aspects qui n'ont que peu de rapport avec le sujet du savoir
.
[90] Daniel Cohen, La propriété intellectuelle, c'est le vol : La propriété intellectuelle rompt avec le schéma de la propriété tout court. Une chanson ou une formule chimique ne s'achètent ni ne se consomment au sens usuel du terme. Elles sont des idées, et non pas des objets, et survivent aux usages privatifs qui en sont faits. Acheter une maison ou une paire de chaussures, c'est revendiquer le monopole légal de leur usage : je suis, moi, dans mes chaussures et non pas toi, sauf si je veux bien te les prêter. Principes en vertu desquels "cordonnier est maître chez soi", et qui font figurer la propriété dans les droits "inaliénables et sacrés" de l'homme moderne. La propriété intellectuelle est d'une tout autre nature. Lorsqu'une idée a été trouvée, rien ne fait obstacle à son usage par tous, sinon la propriété intellectuelle elle-même. Alors que la propriété tout court rend possible l'appropriation d'un objet, le droit de propriété intellectuelle la restreint. Mourir d'une maladie dont le remède existe déjà n'est pas comme envier le propriétaire d'une paire de mocassins qu'on voudrait porter à sa place : ce n'est pas seulement injuste au sens ordinaire du terme, c'est inutile, "inefficient" au sens économique. Les jeunes qui utilisent Napster ne raisonnent pas autrement.
[91] Conseil d'analyse économique, Propriété intellectuelle, Rapports de Jean Tirole (brevet, récompense, secret de fabrication, droit d'auteur, protection naturelle) ; Claude Henry, Michel Trommetter et Laurence Tubiana (biotechnologies, brevet, brevet à durée limitée, certificat d'obtention végétale, secret, délai de production, courbe d'apprentissage ou délai d'imitation, effort de vente/marketing ; Bernard Caillaud (logiciels, droits d'auteur, brevets, droit sui generis), Commentaires de Lionel Fontagné (brevets, partage de la rente) et Daniel Cohen : Il y a une immense différence entre la propriété intellectuelle et la propriété tout court. Dans le cas d'une paire de chaussure, l'usage adéquat du bien exige que soit assigné avec précision le droit à l'usage de celui-ci. Privé de propriétaire, un bien “rival” est à la limite inconsommable. L'analyse d'une économie marchande composée de propriétaires qui s'échangent leurs droits est donc la référence naturelle d'une économie faite de biens rivaux. Dans le cas de la propriété intellectuelle, rien de tel. Une idée peut sans contradiction appartenir à tous, et rien ne garantit qu'un système où toute idée serait protégée par un droit de propriété soit efficace.
[92] François Lévêque et Yann Ménière, Économie de la propriété intellectuelle : La propriété intellectuelle s'étend à l'ensemble des œuvres de l'esprit. Son cadre juridique permet de protéger sous forme de droits exclusifs et cessibles des marques, des innovations techniques, des bases de données, des ouvrages littéraires, musicaux ou cinématographiques, et même des variétés végétales. Chacune de ces créations fait l'objet d'une législation particulière que le juriste réuni sous le terme de droit de la propriété intellectuelle. Pour l'économiste, le droit de la propriété intellectuelle répond à deux impératifs : inciter à l'innovation et faciliter les échanges. […] Pourquoi la loi protège-t-elle les inventions et les œuvres artistiques ? La réponse des législateurs et des juristes est que le droit de la propriété intellectuelle vise à encourager l'innovation et la création, tout en préservant leur usage. Ce fondement est mis en évidence par l'analyse économique en considérant les œuvres de l'esprit comme de la production d'information, bien qui présente deux caractéristiques délicates du point de vue de l'allocation des ressources [Arrow, 1962]. […] En premier lieu, l'information est un bien non-excluable, c'est-à-dire qu'il est impossible d'exclure de l'usage un utilisateur même si ce dernier ne contribue pas au financement du bien. […] En second lieu, l'information est un bien non-rival : sa consommation par un individu ne diminue pas la quantité qui reste disponible pour les autres. […] En offrant un droit exclusif sur une période limitée, le droit de la propriété intellectuelle résout ces deux problèmes de façon séquentielle. […] Il n'existe pas pour l'économiste de ligne de fracture entre la propriété physique et la propriété intellectuelle.
[93] Outre celles que nous avons rappelées, voir également les conflits avec la Déclaration universelle des droits de l'homme : Article 27 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
[94] Brian L. Frye, op. cit. (je traduis) : La théorie prédominante de la propriété intellectuelle est la théorie économique, qui établit que la propriété intellectuelle est justifiée parce qu'elle résout les déficiences du marché causées par le parasitisme et les coûts de transaction. Selon la théorie économique, les brevets et les droits d'auteurs résolvent les déficiences du marché causées par le parasitisme en subventionnant indirectement l'innovation. D'autres formes de propriété intellectuelle, comme les marques et les secrets de fabrique, résolvent également les déficiences du marché causées par les coûts de transaction. Une déficience du marché existe lorsque l'allocation d'un bien par le marché n'est pas économiquement efficace. Le parasitisme et les coûts de transaction provoque des déficiences du marché en empêchant l'allocation efficace des biens. Le parasitisme, ou la capacité à consommer un bien sans en payer le coût marginal de production provoque des déficiences du marché en créant une incitation à abuser des biens rivaux et à sous-produire les biens non-rivaux. Les coûts de transaction, ou les coûts encourus résultant d'un échange marchand, provoque des déficiences du marché en empêchant les échanges économiquement efficaces. L'innovation est vulnérable au parasitisme car, en l'absence de propriété intellectuelle, c'est un bien non-excluable et non-rival. En conséquence, les acteurs du marché sont incité à sous-investir dans l'innovation et à consommer les innovations créées par d'autres, provoquant des déficiences du marché. Un innovateur rationnel marginal investira dans l'innovation seulement s'il peut recouper ses coûts irrécupérables et ses coûts de renonciation en imposant un prix supérieur pour ses biens, mais le parasitisme des concurrents réduirait rapidement le prix de marché du bien au coût marginal de production. La propriété intellectuelle permet aux innovateurs marginaux de recouper leurs coûts en fournissant une subvention indirecte sous la forme d'un monopole limité sur l'utilisation de certaines innovations. En d'autres termes, la propriété intellectuelle résout les déficience du marché dans l'innovation en la rendant partiellement excluable et par conséquent en réduisant le parasitisme. Les marques et les secrets sont vulnérables aux coûts de transaction car, en l'absence de propriété intellectuelle, les coûts d'information et les frais de représentations augmenteraient. Les marques de fabrique réduisent les coûts d'information en permettant aux consommateurs d'identifier la source d'un produit. Les secrets de fabrique réduisent les frais de représentation en rendant plus facile pour les donneurs d'ordre d'empêcher leurs agents de divulguer les innovations.
[95] Roya Ghafele, Comptabiliser la propriété intellectuelle, Département de la propriété intellectuelle et du développement économique, OMPI : La profession comptable est de plus en plus consciente de la nécessité de faire face à l'économie du savoir et reconnaît qu'il faut mettre au point des systèmes d'information tenant compte de l'importance croissante de la propriété intellectuelle. À différents niveaux, aussi bien nationaux qu'internationaux, on tente de répondre sur le plan théorique et concrètement à des questions telles que comment identifier un actif incorporel, comment prendre en compte les actifs incorporels produits au sein de l'entreprise et quelles sont les conditions auxquelles ces actifs incorporels peuvent être réévalués.
[96] Kelvin King, La valeur de la propriété intellectuelle, de l'actif incorporel et du fonds de commerce : L'exploitation des droits de propriété intellectuelle peut prendre de nombreuses formes, qui vont de la vente pure et simple d'un actif à un accord de licence en passant par la création d'une coentreprise. Inévitablement, l'exploitation accentue les risques, tels qu'évalués. L'évaluation consiste principalement à réunir la notion économique de valeur et la notion juridique de propriété. La valeur d'un actif dépend de sa capacité de générer des recettes et du taux d'actualisation appliqué à ces recettes. […] Pour celui qui est chargé d'évaluer des actifs incorporels, l'exercice ne pose en général pas de difficulté particulière si ceux-ci ont été protégés en bonne et due forme par une marque, un brevet ou un droit d'auteur. Mais il n'en va pas de même de biens incorporels tels que le savoir-faire (qui peut comprendre le talent, les connaissances pratiques et les connaissances théoriques de la main-d'œuvre), les systèmes et les méthodes de formation, les procédés techniques, les listes de clients, les réseaux de distribution, etc. Ces actifs peuvent être tout aussi précieux mais sont plus difficiles à dégager lorsqu'il s'agit de déterminer les recettes et les bénéfices qu'ils génèrent. Pour de nombreux biens incorporels, il est nécessaire de procéder, avec toute la diligence raisonnable, à une première analyse très minutieuse en consultation avec des juristes spécialisés dans le droit de la propriété intellectuelle et des comptables de l'entreprise.
